Un lundi soir autour des tables rapprochées les unes des autres, dans un préfabriqué qui serait démonté quelques semaines plus tard à peine, au moment du tour de fin de journée, un des ouvriers de l’atelier d’écriture dit une phrase qui me flingue, il dit, je pensais être quelqu’un loin de tout ça, de l’écriture, mais je me rends compte que c’est peut-être juste, au fond, l’usine qui m’en a éloigné. Et moi je balbutie mes mots pour tenter de répondre à ça. Toute la journée, j’avais eu l’émotion au bord des lèvres, j’avais déjà deux épisodes des Pieds sur terre dans les pattes, et je n’avais pas envie que cette journée-là soit la dernière à écrire ensemble. Eux non plus. Je n’ai pas pu assister aux rendez-vous suivants, mais ils ont sélectionné les textes parmi les quelques 250 écrits, et puis ils les ont travaillés, ils se sont préparés à les lire. Le mail de L. disait : au début, deux seulement voulaient lire et puis finalement, au fur et à mesure de la journée, ils se sont tous décidés, et c’était fou. Quand je suis arrivée mardi matin, c’était fébrile, ils avaient tous mis une chemise, ils étaient si beaux, et surtout, ils étaient terriblement impliqués, concentrés sur leurs textes, leurs papiers surlignés, à répéter consciencieusement les exercices de déclamation que C. leur avait appris, posant une question sur l’intonation d’un mot, sur un geste à faire à tel moment, sur la longueur d’un silence à respecter. Moi j’étais là, un peu en dehors, c’était la surprise, je ne savais pas quels textes ils avaient choisi, ni comment ils les liraient. On s’est mis en cercle et on a fait encore des a a a a a des e e e e e et des i i i i i en étirant la bouche, on a respiré par le ventre et on a raconté des blagues pour rire un bon coup, et puis les gens sont arrivés.
C’était la clôture de la cellule de reconversion, c’était un moment tellement étrange à vivre que j’ai pensé qu’il faudrait encore l’écrire ailleurs, autrement, qu’il faudrait trouver les mots pour essayer de dire ça : la tension d’un événement pareil, la fin de deux ans d’accompagnement, la fin d’un projet donc, mais où beaucoup de gens sont laissés sur la paille, les success stories et les statistiques présentées à ceux qui, finalement, peuvent être dans la salle un mardi à 10h : ceux qui ne travaillent pas. Je me sens toute petite. Et puis J-N. se lève et commence, avant tant de prestance, aujourd’hui, je n’ai rien fait. Je suis tout devant, un peu sur le côté, je vois leurs mains qui tremblent légèrement en tenant les papiers, mais c’est si fort, leurs belles hésitations et la salle attentive. L’après-midi on remet ça, et entre les deux séances, se dessine cette idée d’en faire une pièce de théâtre, ah mais pourquoi pas. Le soir j’attends mon train sur le quai de la gare le ventre serré d’émotions, un peu muette, je pense au livre qu’on en fera, aux rencontres furtives, aux discussions, à F. qui m’a dit, je n’ai pas lu pendant des années, à l’usine, et puis j’ai eu un accident, depuis, j’essaie de rattraper le temps perdu, je pense à tous et à chacun d’eux, à ce qu’ils m’ont apporté, je me sens chanceuse de les avoir rencontrés.
C’était la semaine de toutes les fins, dernier cours avec un groupe que je suis depuis longtemps, alors on va boire un verre après, avant je trouvais que le français, c’était compliqué, maintenant je trouve que c’est toujours compliqué, mais drôle aussi, me dit M. et je souris. Dernier atelier avec un groupe de personnes éloignées de la lecture et de l’écriture, où nous finissons par pleurer de rire, littéralement, à cause des textes de K. et de la façon qu’il a de les lire, et quand le groupe est redevenu plus calme, c’est I. qui prend la parole : Je ne voudrais pas crever avant d’avoir des idées / Je ne voudrais pas crever avant de voir la fin / Je ne voudrais pas crever avant d’avoir un espoir / Je ne voudrais pas crever avant d’avoir écrit un poème / Je ne voudrais pas crever avant de lire mon livre.
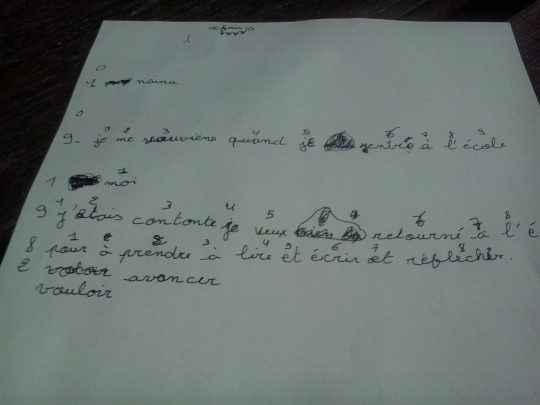
Dernière manifestation aussi du projet autour de Magritte, Ceci n’est pas un poème, une table-ronde où répondre à quelques questions, et un lieu où fêter la sortie du livre, il est petit, il est carré, et il est très beau. A l’exposition, chacun signe celui des autres, et c’est gai, ce grand moment de dédicaces. Il y a M. qui est là et que je n’ai pas vue depuis des mois, alors on en profite pour aller boire un verre juste après et comme d’habitude, elle salue au moins dix personnes pendant l’heure qu’on passe ensemble, alors qu’on n’est même pas dans son quartier. Ça me fait rire et les couleurs qu’elle porte – turquoise, et rose et vert, me mettent du baume au cœur.

Quelques jours avant tout ça, une libraire, que je ne connais que par mail mais qui a dormi à l’appartement d’à côté quand nous n’y étions pas, m’écrivait : je ne savais pas que tu avais un texte publié en FLE ! et c’est à peu près comme ça que j’ai appris que ce livre-là était sorti. J’ai hâte de l’avoir entre les mains, c’est un texte de l’été si fou, l’été 2013, un texte écrit depuis la maison de mes grands-parents en Auvergne, au retour du grand voyage depuis le Kirghizstan, mais en pensant à mon copain argentin de Slovénie, alors ça mélange un peu tout, surtout que ça se passe là où je ne suis jamais allée, en Alaska, et c’est émouvant de le savoir là, disponible, dans des librairies.
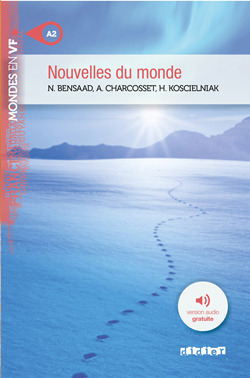
Souvent maintenant, je repense donc à cette phrase sur l’usine qui éloigne de l’écriture, et j’essaie de saisir cette chance que j’ai, moi, de ne pas avoir été éloignée de l’écriture, de même être plutôt dedans, ou en tout cas pas trop loin. Dans mon agenda du mois de juin, j’essaie de dégager des plages sur lesquelles j’écris écrire, tout un concept. Il y a eu, par un beau jour de mai, Hubert Haddad qui parlait de surgissement de la poésie dans les magnifiques jardins de la Maison d’Erasme, et il y aura encore des journées à me laisser porter par les propositions d’écriture d’autres personnes dans les semaines qui viennent. Un mercredi, après quelques après-midis et nuits passion Prezi, j’anime une formation sur l’intégration de l’atelier dans la classe de langue, j’essaie de transmettre un peu de ce qui m’anime moi, justement. Il y a aussi des étudiants de master, je bavarde avec l’un d’eux, et je me sens si loin de ce temps des études et en même temps vraiment pas, c’est toujours mon hésitation quand on me demande depuis quand je travaille, je ne sais pas où il faut commencer à compter. Mais en tout cas, ça déclenche quelque chose, cette formation, l’envie peut-être de partager encore un peu plus.

Alors ces temps-ci, entre deux préparations de cours, on répond à des appels à participation avec le garçon d’à côté, chacun de notre côté ou bien à deux, l’autre toujours plutôt prêt à suivre si jamais. J’aime bien nos projets de co-capitaines de radeau autogéré, et puis nos semaines de vadrouille estivale qu’on invente, parce que c’est quand même plus facile qu’un avenir. On fait des plans, on y met du vélo et du stop évidemment, une tente, des copains, des errances, des battements de cœur et d’ailes, on sera presque tout le temps ensemble avant de ne l’être pas du tout pendant presque aussi longtemps, alors en profiter, avidement. Il est souvent ailleurs, et quand on me demande où, j’ai toujours quelques secondes de réflexion avant de pouvoir répondre, Nantes ou Londres, Lausanne, Paris, Brest ou Orléans, j’essaie de suivre le mouvement, mais ce n’est pas évident. Il va même à Lyon faire une conférence à laquelle assistent mes amis et mes parents, moi j’ai l’air bête à la même heure à Bruxelles à corriger des copies, non mais franchement. Quand il n’est pas là, je dors les velux ouverts, et quand je vais me coucher bien trop tard après avoir bu une bouteille de vin avec A., au-dessus de ma tête, j’ai pile la grande ourse par la fenêtre.

S’éclipser, Aliette Griz
Quand il est là, on part faire de grandes balades à vélo, on pédale jusqu’aux serres royales ou tout le long de la promenade verte, il rentre plus vite que moi sous la pluie mais quand je pousse la porte, il y a l’odeur du chocolat chaud au lait de noisettes. Un jeudi férié sous les hauts toits de FoAM, à bosser côte à côte pendant que la pluie crépite, et le lendemain, on n’a plus qu’à partir pour les Pays-Bas. Là encore, on pédale on pédale, l’euphorie des itinéraires, la carte que je lui laisse lire alors que je m’absorbe dans le paysage, le mouvement régulier des jambes qui me fait presque entrer en méditation. Notre belle chambre et sa terrasse, les petits-déjeuners fous, la lumière du soir le long du canal, les vélos sur le bateau pour atteindre l’île, et le grand vent dans les roues, la sieste à l’abri, le pique-nique sur le ponton. J’aime les couleurs que donnent à nos joues les jours dehors. J’aime si fort.



A Bruxelles, il y a mille événements en même temps, j’aimerais être partout, impossible évidemment, mais quand même, quelques conférences gesticulées dont débattre à la sortie des salles, de l’impro, du théâtre qui m’interpelle et me bouleverse, On achève bien les chevaux, un film avec cette phrase qui résonne si fort, choisir d’être heureux, c’est un acte de résistance, que je vais voir avec mon père de passage quelques jours. On arrive un peu en retard, mais le garçon nous explique, vous n’avez rien loupé, il n’y avait pas de son, alors on va recommencer, et je dis, tu vois ça papa, c’est le karma. De la musique ; un concert dans un café-théâtre désert jusqu’à la dernière minute, et puisque Hanneton est de ces amies qui parviennent à mettre votre nom sur des guest-lists, Dominique A et son dernier album fou ; les lumières nous laissent un peu perplexes, on se dit que Dominique A, on l’aimerait comme Bertrand Belin l’année dernière, en acoustique dans un salon, pour profiter de cette voix qui enveloppe tellement.

Et puis parfois, dans tous ces élans, je dérape un peu, je ne sais pas si c’est le trop de projets passionnants trop de boulot trop de choses pas assez de temps pour être seule pour être pour penser pour ne pas penser, mais je fonds en larmes sans comprendre quelques jours d’affilée. De l’intérieur, je vois que ça laisse le garçon d’à côté perplexe, et je veux bien le croire, puisque moi aussi, je me sens désemparée, qui est cette fille qui pleure, qui bascule soudain, où est la joie, bon sang, où est la joie. J’essaie de mettre des mots après m’être endormie et avoir oublié m’être couchée, je dis, comme une crise d’angoisse du monde, c’est les actualités, c’est le musée du capitalisme, c’est la discussion sur 2017, c’est les légumes du marché bio que j’adore qui viennent maintenant de milliers de kilomètres, et mon sentiment d’impuissance qui parfois prend le dessus. Alors je reste un long moment allongée à fixer le mur ou le dedans pendant que lui vient se glisser dans mon dos, et je pense à cette phrase, L’amour est un acte politique, car il est non-productif, garder au moins ça.
Et ensuite ça passe. Toujours un peu plus de mots, de chants engagés à la chorale, de textos doux, d’amis croisés par hasard, d’expérimentations végétaliennes, souvent à des heures pas possibles parce que ce sont finalement les seules qui restent aux journées, un risotto aux poireaux et un parmesan végétal par ci, une tapenade de lentilles vertes par là, un cake au citron et au pavot, c’est enfin la saison de la rhubarbe en tarte ou en crumble, et quand j’enfourne un gâteau à 23h42, il est peut-être encore meilleur ?
C’est enfin la saison de la rhubarbe, les journées longues et les bouts de soirées à regarder les toits depuis la terrasse clandestine, c’est encore mai, c’est presque juin, je m’éparpille un peu, me désordonne, puis me retrouve, la vie revient, on m’a proposé d’animer, un jour, un atelier d’écriture sur l’équilibre, et tout se tient.


