Quand tout à coup je maudis la pluie orteils crispés dans mes chaussures qui prennent l’eau, je pense à deux bout de films, méthodiquement ; d’abord à Totoro sous son minuscule parapluie et à son sourire gigantesque, et puis à cette autre scène, dans Ma vie sans moi, au visage de Sarah Polley qui se tend, qui s’offre à l’eau à un arrêt de bus, je pense à ça, à ces histoires très différentes mais qui me donnent toutes deux si fort envie d’aimer (la vie) encore et plus, plus et encore, et dans mes chaussures qui flic flac floc crac et vzzz et vlan et vroum, je me remets en mouvement, dans ce mouvement de la marche qui vient rythmer mes journées, de parcs en porches, d’avenues en impasses oubliées.


Il y a cette fille que je croise presque par hasard dans Bruxelles si petite, mais finalement, les mots fous des gens fous dans les lieux fous, est-ce que ce n’est pas logique, à un moment, est-ce que ce n’est pas qu’un rendez-vous de plus ? Quand elle m’écrit le lendemain, tu ressembles à tes mots, je me dis que c’est une bien jolie chose à me dire, et j’ai tellement l’impression que toute ma vie en ce moment existe grâce à ces phrases posées depuis si longtemps l’air de rien, que ça me touche encore plus. Toute ma vie, comme le joli magazine reçu où je lis mon nom, comme la voix du garçon d’à côté au bout de cette fichue distance qu’on rattrapera bientôt, comme les mails aux projets qui parlent de voyage et d’écriture, ou d’improvisation – comme tout est bon.


Dans une rue au joli nom comme il y en a tant par ici, rue de la plume, j’échange un pot de crème de châtaignes contre une paire de baskets neuves, j’aime cette vie de troc, cette vie de bric et de broc, de brol, les robes qu’E. dépose sur mon lit pour si jamais elles me plaisent, la lampe amenée par R. comme une pleine lune, la compote de pommes du jardin qu’a laissée cette chère N. à la fin de notre repas où l’on amenait chacune un plat de notre couleur préférée.
Au bar au nom imprononçable où travaillait autrefois C., le garçon offre les parapluies oubliés aux clients qui regardent le ciel avec un peu trop d’appréhension. Nous rentrons à pied dans la nuit après quelques bières, puisque je ne connais pas encore mes arrêts de tram sur le bout des doigts, l’amoureuse de Y. porte une grosse boîte en fer qu’elle a trouvée sur un bord de trottoir, et depuis l’après-midi, il s’est arrêté de pleuvoir. Y. est parti en Afghanistan le lendemain comme si c’était normal, et peut-être qu’au fond, ça l’est, je ne sais pas très bien.
Dans le salon aux sept fenêtres, les éclairs venant du tram projettent des fulgurances bleues – fulgurance blues – que je chéris, et nous essayons de réveiller le chat-brol pendant que nous mangeons, pour qu’il dorme plutôt plus tard, lorsque nous travaillons. L’automne s’ensuit et tremble parfois, des cours particuliers dans un petit bureau avec une chouette ado, des rires qui s’agitent dans la salle onze au milieu des erreurs de français, et mon angoisse de ne pas être à la hauteur que je ne sais pas toujours très bien contrôler. Je cherche mes repères, et mes questionnements pédagogiques réveillent plus de choses qu’il n’y paraît – je les bouscule dans plusieurs carnets en même temps, pour que ça ne me semble pas démesurément grand.
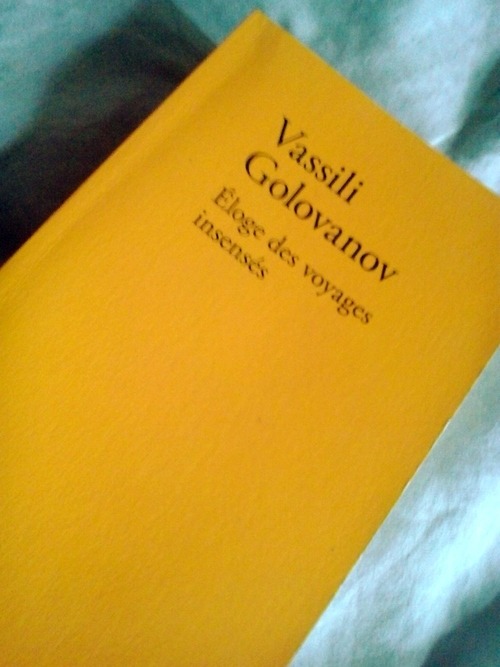
J’ai fait mon premier week-end ailleurs dans l’ailleurs. A A. qui fumait sa clope devant les Halles Saint-Géry avant d’aller chercher T., je lui disais la peur que j’avais de ne pas réussir à m’extraire totalement, à couper avec la vie d’ici pour me replonger dans nos souvenirs d’il y a quatre ans, mais je me trompais – ce ne sont jamais dans nos souvenirs que nous replongeons, ou jamais seulement dans ça en tout cas ; c’est toujours plein des présents, toujours vif, et vibrant. J’aime voir le groupe qui s’agrandit au gré des heures et des allers-retours vers les trains, notre vie d’Erasmus reprendre forme sur des quais de gare, et même S. du Japon, pour la première fois quatre ans plus tard. S. est si follement là, si évidemment là, et je ris de la voir sortir des surprises de son sac toutes les quatre heures environ. En vrac, le goût de la fondue, les gaufres de minuit parce que quoi d’autre, les cocktails que T. fabrique selon nos désirs, des couleurs, du sucré, de l’acide, a bitter-sweet symphony, c’est possible ? c’est ma vie, le train que nous prenons ensemble pour la campagne, la maison de L. dont on voit l’intérieur dans la nuit qui descend, le chemin éberlué des lumières du soir, et les mots qui comptent, et les voix qui domptent. Et Mam et ses belles émotions, la manière qu’elle a de savoir dire les choses malgré tout ce qu’elle peut croire, et les fous rires, et les craies de couleurs et l’humour toujours noir. Sur les trottoirs de Bruxelles, j’aime observer comment les couples se font et se défont, comment les discussions s’interrompent au gré des évocations, des appels, des intonations, des jeux de mots, des références, et comment elles reprennent plus tard, au détour d’une cigarette, au-dessus d’une vaisselle, à l’entrée d’un couloir. Les lits que nous partageons, dans la nuit ou au matin pour d’autres discussions. Je crois que ce qui nous tient, c’est la tendresse de ce groupe, le respect des fonctionnements de chacun, les mots qu’on gueule dans les interphones, les énergies qu’on respecte et qui se coordonnent. Dans la voiture qui ramène Mam à la gare, nous parlons d’un nouvel an en Bretagne, d’un bord de mer, et ça sonne bien dans nos espoirs. Plus tard, un premier mail sur le sujet, ce sont nos possibles fous, nos anodins de rien du tout.



Et puis la vie reprend son cours normal qui ne l’est jamais tout à fait, parce que les détails, parce que les surprises, parce que normal est un mot que je déguise. C’est bien la première fois depuis longtemps que novembre n’a pas besoin de cinquante mille mots pour tenir le coup, une carte que le garçon d’à côté poste depuis le Maroc, novembre est en promesses, en vents froids mais en billets doux.


