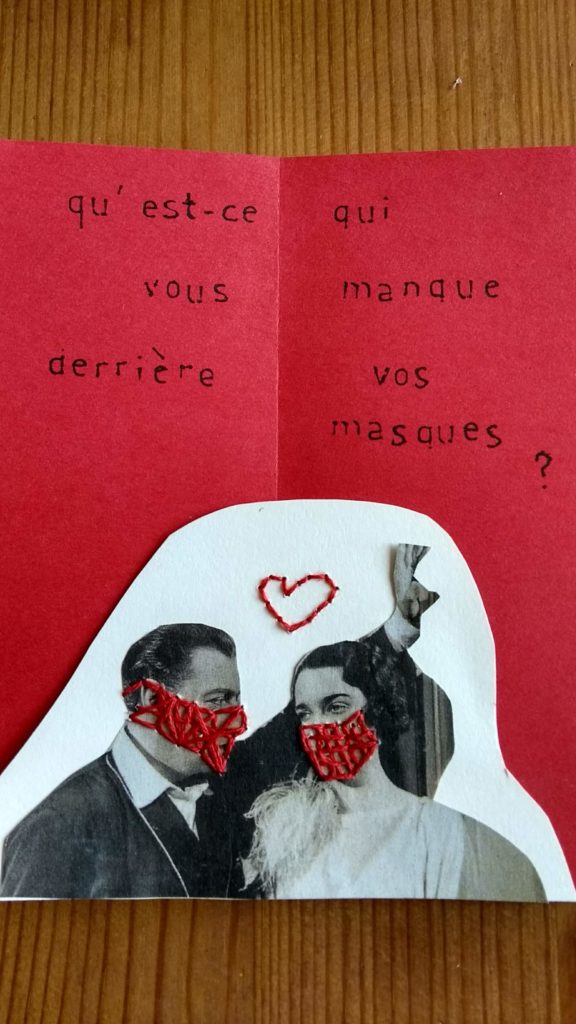Quelque part cet été, La souris, dans son journal, a annoncé qu’elle avait mis à jour sa blogroll, et quand je l’ai parcourue, j’ai découvert cet endroit-ci dans la catégorie « en pause prolongée ». Ça m’a surprise, et touchée. Touchée, je l’ai été encore plus, quand j’ai lu qu’elle disait que j’étais « douée pour le bonheur ». Je me suis demandé si c’était vrai. Si ça l’était quand j’écrivais ici, et si ça l’était toujours maintenant que je n’y écrivais plus. Après ça, je suis partie en voyage à vélo quelques jours, seule, et j’ai eu envie de raconter ces jours-là, ici. Et puis la rentrée m’a engloutie et les notes sont restées bouillonnantes et brouillonnes. Mais fin septembre, je suis repartie, et l’envie est revenue toquer, encore, alors cette fois-ci, je l’attrape et je vais jusqu’au bout. Même quatre ans après, apparemment, le thé est encore chaud.
***
Au début, quand je pensais à ces trois jours-là alors que j’étais en train de les vivre, je me disais « ma petite aventure », « une petite aventure à ma mesure », et puis je me suis forcée à enlever le « petite ». Une aventure, oui, minuscule ridicule non, une aventure à ma taille, à peine plus grande que moi, une aventure dans laquelle j’étire mes jambes et mes bras. Bien sûr, ce n’est pas partir un an au Kirghizstan (et parfois, l’étrangeté : ai-je vraiment été cette fille-là ?), ce n’est pas en rentrer en stop, c’est quelque chose qui tient mieux entre les mains, et qui a du sens, et de l’intentionnalité, et qui vient, comme un baume, nourrir et réparer. L’idée pointe la semaine qui précède alors que je tarde à m’organiser et que j’en suis encore à surnager dans ma rentrée, collée à mon écran bien trop d’heures d’affilée. L’idée, donc : et si j’allais marcher ?
Si là, dans ce séjour breton, je longeais la côte, et j’avalais quelques kilomètres, puisque de toute façon, je vois bien que je ne pourrai pas tout faire, aller voir toutes celles à qui j’avais pensé, rejoindre toutes les villes que j’avais repérées. C’est que naïvement, je croyais qu’après les huit heures de train, tout serait à portée de main. Jusqu’à me poser sur la carte un peu plus sérieusement, et le constat : ah oui, la Bretagne, c’est grand (!).

Alors, plutôt que de courir de gare en gare, je décide de ralentir. De faire quelque chose que je n’ai jamais fait : marcher seule plusieurs jours de suite. C’est qu’avec moi, j’ai les récits de certaines qui font ainsi : Nathalie Sejean, mon amie Mel et Mélanie Leblanc, Jane et Sauvage, même si c’est à vélo, et Christie, il y a quelques années avec son chien, toutes à leur manière m’ont donné envie, plus que les aventurières d’il y a quelques décennies, même si bien sûr je ne crache pas sur Ella Maillart ou Alexandra David-Néel. C’est juste que là, ça s’inscrit mieux dans l’ordinaire, dans un « moi aussi je pourrais le faire ».
Dans le fond, qu’est-ce que ça me demande, qu’est-ce que ça vient chercher et chahuter ? La peur de ne pas être capable, d’avoir un sac trop lourd (et oui oui, ce sera évidemment le cas) et un corps en carton, de me perdre alors que pour le voir à chaque fois que je pars en voyage à vélo solo, c’est plutôt que je ne cesse de me retrouver. Le garçon d’à côté est un peu envieux, lui aussi aimerait prolonger la vadrouille et se mettre de la mer plein les yeux. Je regarde une carte (un peu), réserve des hébergements, râlote parce que c’est plus difficile qu’à vélo, où je n’ai pas besoin d’être très précise ni minutieuse — on n’est pas à 7 kilomètres près. Je vérifie les points de ravitaillement, et je préviens M. que j’arriverai chez elle à pied. Ça me met dans une joie délicieuse, car j’avais déjà expérimenté de débarquer chez des gens en voiture en train en avion en stop à vélo en camion de déménagement. Mais à pied en lui écrivant trois jours plus tôt, « bon, je me mets en route », ça, c’était nouveau.

Quand je commence ces trois jours de marche, j’en ai déjà sept de voyage derrière moi. Sept, soit le temps d’un sac à dos volé puis miraculeusement retrouvé, d’apéros devant la mer qui n’en finit jamais de changer, des premières courges qui annoncent l’automne, de plusieurs librairies visitées, de deux exemplaires du dernier Mona Chollet, de rencontres qui ont l’air de retrouvailles, de discussions qui durent longtemps et qui pourraient durer encore plus, d’heures du thé et de galettes et de goûters, de trains et de cars et de cars et de trains, de rires et d’amitiés.
Quand je commence ces trois jours de marche, donc, c’est pleine de tout cela et d’autres choses encore. C’est L. qui m’amène à l’arrêt de bus. On a les petits yeux du matin brumeux, la nuit n’a pas beaucoup dormi, on se serre dans les bras, comme liées cimentées par les mots surgis la veille et le fait de s’être, en se les disant, reconnues. Elle repart, l’embrayage de sa voiture fait du bruit, je souris et l’autre femme qui attend le bus avec un sac à dos aussi, et la discussion amorcée cette nuit-là continuera à infuser, oui, longtemps infusera. Entre deux cars, je défais et refais mon sac, enlève des cartons d’emballage, compacte mes affaires, et je sens le poids de la peur — bien sûr que je sais que je prends trop, enfin, plus que je ne le sais, je le sens, mais là tout de suite, je n’arrive pas à faire autrement.
À Bréhec plage, je suis la seule à descendre, le sol dit : ici, la mer commence. Ici la marche commence, ici je me mets en route, je me hisse au-dessus de la mer dans les premiers escaliers du trajet. Pendant trois jours, cela va ressembler à ça : trouver le rythme qui convient à soi. Ne rien devoir à personne, ne pas chercher à faire comme, simplement écouter de quoi mon corps a besoin. Plus vite plus lentement, une respiration, de l’eau à grandes goulées, un tour de cou, un bonnet, une veste ouverte, une pause, un étirement, s’en mettre plein la vue, marcher tranquille, s’arrêter puis se remettre en mouvement et parfois, soudain, l’apaisement : là, il n’a besoin de rien, tout est bien.

Sur le chemin, je ne croise pas grand-monde, surtout les matins qui commencent sous la pluie. Quelques coureurs, rarement des femmes, quelques couples aux abords des parkings, mais dès que j’ai fait 400 mètres dans un sens ou dans l’autre, je suis seule. A. le premier soir fait la route pour me rejoindre exprès, et c’est chouette de se voir en vrai. Une verveine, une galette et une plage de galets, et après les émotions et les kilomètres, ni l’une ni l’autre ne fait long feu. C’est un jeudi, j’ai cette impression exaltante d’école buissonnière — alors c’est ça, les vacances de septembre, et c’est un supplément de joie que la sensation de voler quelque chose sans que ça n’enlève rien à personne. Dans la chambre d’hôtes du deuxième soir, je suis la dernière randonneuse de la saison. Après moi, F. fermera sa porte jusqu’en mars, c’est le dernier petit-déjeuner qu’elle prépare. Elle y met du thé irlandais, parce qu’elle revient juste de là, de cet endroit où je lui disais avoir habité il y a un petit paquet d’années.
Quand même, le premier jour, je croise une autre femme qui marche, peut-être plusieurs étapes elle aussi. Il fait grand bleu mais son sac est planqué sous une cape, et ça me surprend suffisamment pour que je m’en fasse la réflexion. Je comprends le pourquoi du comment deux heures plus tard, quand, en train de prendre un bain de soleil sur un banc en haut de la montée, je me retrouve trente secondes après complètement rincée. J’ai à peine eu le temps de sortir mon sur-sac. Alors une fois qu’il est calé, je ne l’en délogerai plus. Non, il n’aura pas besoin de moi pour partir à son tour en vadrouille, puisque quelque part dans le deuxième jour, il prendra la poudre d’escampette dans le grand vent, dans le si grand vent que je n’ai rien entendu : avant il était là, et tout à coup, il n’y est plus. Je regarde autour de moi, mais combien de temps ça fait que je marche sans lui, j’espère qu’il fera une heureuse un heureux, et moi en attendant, j’accroche solidement sur mon sac ma cape de pluie.

Dans les bonjour échangés, il y a ces gens qui randonnent à la journée, je suis en descente et eux en montée, et ils s’exclament, « C’est plat, la Bretagne ?? Tu parles… ». Un homme promène son chien et presse le pas avant l’orage ; il jette un œil au ciel et me dit « bon courage ». Au final, je ne sais plus quel temps il fait, ça change tout le temps, du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie, du vent. Oui, je suis trempée en une minute et sèche en vingt, une semaine plus tôt j’avais commencé à regarder la météo qui disait juste « pluie », et le seul truc qui bougeait, c’était l’indice de confiance qui augmentait. Alors j’avais arrêté, histoire de ne pas trop déprimer. Finalement, il a fait autre chose que ça, mais je ne saurais pas non plus dire exactement quoi.

Ce que je peux dire par contre exactement, c’est le parfum des thés celtes que je bois, « abricot et gâteau d’antan », « pommes, crème, amande et pépites de chocolat », thé Bréhat ou thé Groix. Dans la crêperie où je me réfugie le deuxième jour, il est 12h10 mais la serveuse dit « bonsoir » aux gens qui arrivent derrière moi : il fait si diablement sombre qu’on en vient à douter. Norah Jones dans les haut-parleurs, les lumières jaunes, les tables en bois, et d’ici, j’entends le garçon d’à côté qui dirait : ça, c’est pile un endroit pour toi. Ça, c’est pile un endroit pour moi, celui aussi où l’affiche annonce, le soir même : « chanson et accordéon ». J’y fais une pause plus longue. Le corps est un peu las, ne peut aller beaucoup plus loin, mais pour chanter par contre, il reste apparemment de l’énergie, ça oui. Alors après, revivifié·es, mon corps et moi, on peut à nouveau avancer, marcher, se perdre, finir l’étape, prendre toutes les rues aux noms d’oiseaux — albatros bernache mésange goéland, jusqu’à trouver la bonne.

Je commence les heures de marche accompagnée par un message de mon père qui m’a écrit un poème autodaté, après avoir découvert dans ma lettre du dimanche ce que c’était. Je lis ses mots éberluée et je les garde au chaud sous ma veste. J’ai beau randonner seule, je me sens très entourée, en lien avec chacune des amies qui habitent ma vie. Beaucoup d’émotions me traversent, des images, des sanglots des rires des je ne sais pas trop. Dans les notes de mon téléphone, je capture une phrase qui s’impose pour les remerciements dans mon roman et je tremble un peu en l’écrivant. J’écoute des podcasts avec Adélaïde Bon et Gaël Faye et Julia Kerninon, ou bien le silence de la forêt et le boucan de la mer, le clapotis de la pluie et les bourrasques du vent. J’écoute Noé Preszow, le bruit de mes pas et celui de mes bâtons, j’écoute les heures qui passent et les cailloux qui glissent. Le mot qui gravite, c’est gratitude, pour celleux tout autour, pour les jours buissonniers, pour cette autorisation que je me suis donnée, et aussi pour le corps. En me sentant en route, je comprends, vaguement, qu’il peut être un allié, qu’il l’a déjà été, mais que souvent j’oublie. Allié, c’est sans doute ce qu’il est, quand je trouve, en colère et piétinements, que la mémoire prend trop son temps. Mais je pourrais aussi me dire que lui sait ce qu’il fait encore bon protéger.

Ces voyages, cette rando, ou cet été ces jours de vélo, solo, ce sont des échappées belles, des moments où je me sens de nouveau capable, où je fais le plein de confiance en moi. Comme des pendants au long et lent travail du texte que je tente d’écrire, que j’écris depuis x ans, et qui me bouscule parfois jusqu’à me faire presque basculer, un peu comme le grand vent de l’arrière-saison.