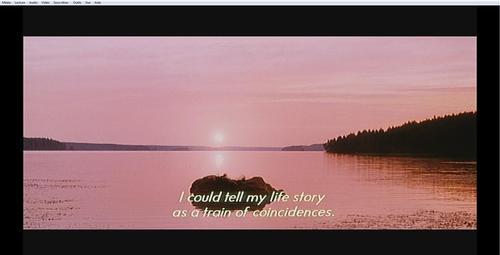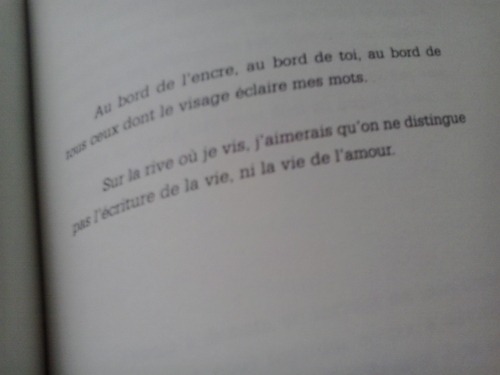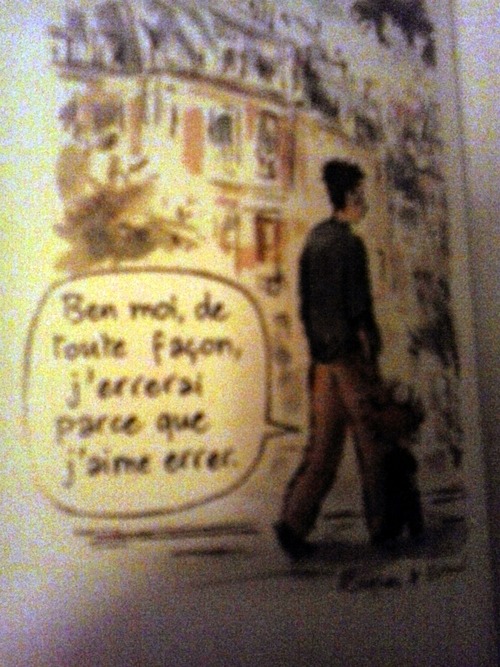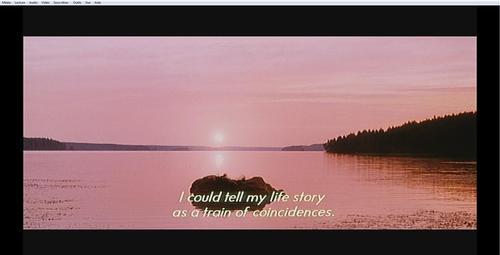*Bertrand Belin
Sur la route un matin, j’ai perdu mon sac à cistes, celui qui contenait mon carnet et toutes ses pancartes de stop depuis Istanbul il y a un an, et la petite boîte de peintures qui me permettait de prendre mes inspirations sur les aires d’autoroute, de tracer mes lettres, de franchir le pas, de lever le pouce. Je n’ai pas eu le temps d’être triste tout de suite : une minute plus tard, j’embarquais avec un mélomane d’une soixantaine d’années qui sillonnait la Bretagne pour aller voir des festivals, et nous parlions musique pendant deux heures, je gribouillais des noms de choses à écouter sur un tickets de bus de Rouen, avant qu’il ne me dépose là, dans l’enceinte même du petit camping municipal de Quimperlé, environ dix heures avant l’arrivée prévue du garçon d’à côté, qui, lui, n’avait pas encore quitté son chez-lui à l’autre bout de la France.

Pour arriver jusque là, il y avait déjà eu avant deux autres jours de voyage, à peine arrivée sur la première aire d’autoroute après mon chemin en bus et à pied, j’avais squatté la voiture trouvée par un autre autostoppeur arrivé avant moi, parlé de cuisine grecque, évité une évangélisation un peu forcée, et rencontré une animatrice d’ateliers d’écriture avec qui je m’étais trouvé une amie commune que j’allais voir une dizaine de jours plus tard justement. J’avais été accueillie par K. et ses salades folles à Rouen puis par H. quelque part vers Rennes, j’avais vu et aimé un film dans une petite salle de cinéma, eu une discussion inattendue sur les relations entre frères et sœurs avec un chauffeur-livreur de crustacés, rencontré un géologue néerlandais, un couple franco-polonais, et une femme qui avait fait un détour pour me déposer à un endroit parfait : oh, ça me fait tellement plaisir, vous êtes comme ma parenthèse enchantée, et aussi, je vais parler de votre parcours à mon fils, il a 17 ans, je pense que ça va l’inspirer, j’avais bégayé.
Mais donc, là. La journée à Quimperlé, cruelle d’attente, s’est étirée, j’ai marché dans les rues et dans la forêt, j’ai écrit beaucoup, j’ai bu un demi-framboise sur la grande place pour tenir jusqu’au soir, jusqu’à sa bouche sur un quai de gare, c’est bon et kitsch peut-être, et tant pis, jusqu’au gamin qui nous interrompt, est-ce que le train est déjà passé ?, oui depuis, depuis, depuis quand déjà, combien de temps à s’embrasser là ?

Quand je le retrouve, ça a toujours le goût de l’évidence, et comment ai-je pu croire, enfin, comment ai-je pu, alors que nous sommes parfaits, pour nous, ici, maintenant. Notre radeau des vacances sera une tente, qui voguera d’un jour à l’autre, démontée chaque matin, remontée chaque soir, après les journées de marche à être seuls sur le sentier des douaniers, à aimer tellement le paysage, les paysages tant tout est mouvant, les étangs, le sable, la rivière qui va jusqu’à la mer, le pique-nique sur ce rocher qui s’avance dans l’eau, les escalades, les aiguilles de pin partout, les ombrages, les péninsules, et les bras sous la marée. Nous faisons de longues pauses et de petits kilomètres, quand les gens nous demandent jusqu’où nous allons, je me rends compte que nous nous excusons presque, de ne pas marcher plus, de ne faire que, mais au fond on s’en fout, parce que la chaleur et le poids des sacs, et puis surtout parce qu’il n’y a pas de concours, nous ne sommes pas pressés si ce n’est de nos peaux, il y a juste l’envie des pas l’un devant l’autre, d’être là côte à côte, de partager ce rythme et ces langueurs, cet été qui nous porte. Le matin, les gens nous voient quitter les campings à pied, et nous disent, ah mais bon courage ! mais faut-il du courage, vraiment, pour prendre les chemins le jour, et la nuit compter les vers luisants et les étoiles filantes ? Il y a les crêpes le soir, les parties de mastermots que nous inventons, nos duvets qui ne s’accrochent pas ensemble, l’eau dans laquelle nous n’arrivons pas à entrer entièrement tant elle est froide, les coups de soleil et ma casquette si swag, la carte qu’il me laisse lire et interpréter, la tente qu’on ouvre à l’aube quand il y fait trop chaud avant de nous rendormir l’un contre l’autre, les mots les mots les mots, une incompréhension éclaircie alors que la pluie tapote la toile de la tente, et son cou ensuite, être toujours bien là, cet endroit que j’habite. Le lendemain, la lumière est jaune et englobe tout, la vie se réveille et j’écoute les bruits du matin, la fermeture éclair d’une tente, l’eau qui glougloute à la fontaine, les mouettes, les voisins qui font leur bagages. Je vais acheter des croissants pour les décroissants et reviens alors qu’il dort encore, et j’écris que je voudrais continuer ce rythme de la vie jusqu’à au moins plus loin, toujours plus fort.

Mais un matin, il faut partir, se séparer à nouveau alors qu’il me semble que nous nous retrouvons à peine – c’est un été pointillés, comme l’été dernier, l’été premier, à ne pas savoir toujours exactement quand les routes se recroiseront, il attend à quelques mètres de moi tandis que j’agite mon pouce, c’est un entre-deux, encore ensemble mais plus tout à fait, et quand une voiture s’arrête, on se sépare sur un baiser, j’explique à ma conductrice que nous partons dans deux directions différentes, elle demande, euh, géographiquement ? et je dis, oui, pas métaphoriquement, heureusement. Il me faudra treize voitures pour rejoindre la Normandie et beaucoup de sauts de puces ; je n’ai plus de batterie sur mon téléphone et aucune notion du temps, l’attente se dilate et je suis souvent incapable de dire aux automobilistes depuis quand je suis là. Il y aura là au moins un Hollandais graphiste, une Brésilienne chorégraphe, une fille aux cheveux roux qui me dit que j’ai une belle énergie, de trop longues minutes à être mal placée jusqu’à la délivrance, un garçon à chapeau qui me fait si fort penser à Andrej, une caisse de la biocoop à mes pieds, une famille au petit garçon qui me parle de châteaux, un homme qui fait un film, et puis un couple aux voix tellement apaisantes, et aux paroles aussi, finalement, quelque chose de très doux, puis un homme qui me dit qu’il faisait du stop plus jeune, et quand il n’en faisait pas, il démarrait les voitures avec les fils, ah ben ça, il fallait bien avancer, mais maintenant, tout ça, c’est fini, je suis grand-père, une mère de onze enfants, et aussi, et encore… Pendant que j’attends alors que la journée tombe, une rencontre inattendue ; un couple à pied, lui est en kilt et elle s’approche tout près pour me chuchoter, il paraît que ça porte chance, alors je vous dis merde, comme si elle avait peur de se faire entendre. Je les remercie et leur offre l’oiseau en papier que j’étais en train de fabriquer. Et puis encore deux voitures jusqu’à la place de Pirou où j’arrive dans le début de la nuit, cet endroit où je viens depuis quatre ans, je file embrasser mes chères à la terrasse du café, là où ça grouille de gens et d’énergie.
Le lendemain, c’est le marché, le petit studio dans lequel je m’installe, une heure près de la mer que j’arrive à grappiller avant que le festival ne commence, et déjà, ce rendez-vous dans le jardin du presbytère, et toutes les retrouvailles, tous ces gens qu’il fait bon saluer. Je me cherche un peu les premiers jours, le passage du deux au quatre-vingts sans doute, de la solitude du nous à la multitude de voix, du chemin qu’on trace comme on veut à celui qu’on suit tous ensemble, de l’automatisme des pas l’un devant l’autre qui me manque, de s’occuper de soi à être référente pour les autres. Je balance, j’équilibre, je m’émeus sur des chansons gueulées au piano dans le restaurant au bord de la mer, dont les pieds des tables s’enfoncent dans le sable, j’ai des larmes, mais elles ne sont pas que tristes, peut-être même plutôt pas, mais c’est toujours difficile à expliquer. J’anime des ateliers d’écriture, on tire des tables mi-ombre mi-soleil ; un matin, c’est l’heure des compliments, entre J. qui me parle de ma posture d’animatrice – et ce que j’essaie de mettre en place toujours même si je ne sais jamais si ça se ressent, c’est apparemment là et bien là –, Y. du recueil de textes dont je me suis occupé et qui l’a presque mis en retard tant il y était absorbé, M. qui me parle de ce qu’elle voit de moi et du garçon d’à côté, souvent, à Bruxelles, de comment ça la touche – et moi donc, et moi donc. Je tombe en admiration devant Lucien Suel et j’écris à partir d’un de ses vers sans jamais oser lui parler, je propose des séances de bibliomancie deux jours d’affilée et nous rions aux larmes, aux larmes je vous dis, à cause de ce que les livres offrent de juste. J’écris, j’écris, je me sens écrire, contre le mur du jardin, je reprends le texte laissé en friche depuis …, je capte des alexandrins dans la voix d’un guide, et je fais des sonnets de rien. Nous partageons le studio avec F. et A., mes belles rencontres pirouésiennes, et nous parlons des heures le soir avant de nous endormir toutes les trois alignées, il y a des émotions des confidences des révélations des connivences, et c’est une bonne idée, que cette colocation d’été là, même si je n’en doutais pas. Un soir, il y a le plateau de scrabble géant sur la place où nous inventons mille mots aux définitions profondément décalées, les gens du bar viennent apporter un projecteur, et nous pourrions rester là encore longtemps. Le vendredi, j’ai applaudi les enfants et leur pièce de théâtre aussi fort que d’habitude, aussi bluffée que les autres années, par ce spectacle monté en cinq jours, et j’aime qu’il y ait des lieux comme ça, où tout soit possible. Sous le chapiteau, Y. nous sert un vin que vous n’avez jamais bu, mais que nous voudrions certainement boire plus souvent. Il y a des gens disparus dans la nuit, je n’aime pas les au revoir qui s’éternisent, mais j’aime encore moins ceux qui n’ont pas lieu. J’ai dansé un après-midi, même si ça ne m’a pas vraiment plu, j’ai ri j’ai parlé, j’ai confié j’ai vécu. Avec Fr., on a conduit le poème de marche jusqu’à la mer, en cercle assis dans le sable, on s’est récité. Un matin j’ai noté :
Entre la foule
Et la houle
Chercher
L’espace
D’être soi.


Et on repart, un peu embuées de tristesse, cet au revoir à la mer, trois à s’étreindre les pieds dans le sable, dans le matin qui pleut pour la première fois depuis qu’on est ici, comme pour nous dire, voilà, allez-vous-en, ne regrettez rien, vous reviendrez bien, et puis dans la voiture jusqu’à Rennes, quand les averses se déchaînent sur le pare-brise, je me dis que je n’ai pas très envie de stopper, heureusement qu’au bout de la route, il y a le garçon d’à côté. Mais bientôt le soleil revient, je prends un chemin de brigand, dépasse le rond-point. J’aurai besoin d’une voiture et d’une seule alors que pourtant, il fallait descendre, contourner Angers, et ensuite, trouver quelqu’un sur la toute petite route, mais voilà, il suffit d’un homme qui va jusqu’à Tours et qui n’aime pas prendre l’autoroute, et le tour est joué, je ris et je pense à cette phrase que le garçon d’à côté aime citer, j’ai mille problèmes qui ne me sont pas arrivés. Je le rejoins dans le village au joli nom, les rosiers, devant la fontaine à bascule, il ne m’attendait pas si tôt et c’est bon, ces heures gagnées sur la surprise, la maison de l’autre côté de la Loire, où il a déjà posé ses affaires et vers laquelle nous marchons.



C’est une maison parfaite, c’est pour nous pendant trois jours et trois nuits, ces pierres et ces pièces, cet immense jardin sauvage, cette tonnelle, la Loire à cent mètres. Je tombe amoureuse de la lumière, de cet espace et de la façon dont il est aménagé, des repères de voyage laissés partout, des affiches japonaises, des tentures indiennes, des poufs, du futon, du lin, de l’osier, de la douceur du lieu, de sa fraîcheur aussi. Nous buvons le vin que j’ai porté dans mon sac depuis la Normandie. Presque un an, je lui poème dans l’oreille ; un an, je lui offre ce livre qui me parle tant de lui mais qu’en vérité il connaît déjà et qu’il relit contre moi. Trois jours, nous balader, préparer des risottos et des crêpes sans œufs ni lait ni rien, elles sont quand même parfaites, aidées par le caramel au beurre salé de Bretagne, faire la sieste et parler, découvrir ce groupe d’inspiration yiddish et tsigane et adorer, écouter un album de Florent Marchet pendant qu’il sommeille, rester le plus possible dehors, jusqu’au frais sur les jambes et les bras, s’endormir tôt et se réveiller pourtant tard, récupérer de ma fatigue et me charger contre lui. Nous pourrions regarder la Loire des heures, la tente qui s’installe sur l’île en face, cette envie de pédaler au bord du fleuve, de tendre des hamacs dans la forêt. Des plans, des plans pour d’autres fois, d’autres temps, d’autres endroits. Cette fois encore, je suis triste de partir, même si cette fois nous partons ensemble, il y a tant de lieux que j’aime, c’est une chance de les connaître et à la fois un déchirement de s’en aller, je m’imaginais bien là, au grand bureau sous la fenêtre, écrire et refaire du thé, venir m’exiler.

Cette fois, il faut traverser un bon bout de la France, on s’arrêtera en Auvergne dans la maison de mes grands-parents pour un repas et du sommeil ; rapidement, il y a une voiture où nous nous serrons avec deux enfants, un couple d’Australiens, une femme seule qui dira, oh c’est passé très vite avec vous ! Plus tard, un peu avant Vierzon, deux heures d’attente, comme la dernière fois, presqu’au même endroit, alors comment ne pas chanter T’as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon, même si même pas, même si on ne connaît que les aires d’autoroute qui l’entourent, et la frustration de l’attente alors qu’on est bien placés, qu’on va demander, qu’on fait tout comme d’habitude. Je me dis que c’est peut-être pour ça que j’aime le stop et lui moins, parce qu’il n’y a pas de lois, et que je ne suis pas sûre qu’il y ait possibilité d’apprendre beaucoup de ses erreurs (parce que je ne sais pas quelles erreurs peuvent vraiment en être) ; il y a des fois où au bon endroit j’ai attendu des heures, tandis que mal placée, j’ai été prise en deux minutes, où j’ai erré sur des aires énormes et pleines de passage alors que j’ai à peine eu le temps de m’arrêter dans de petites aires sans rien, où pleine d’énergie j’ai lutté, alors que fatiguée et vidée, j’ai trouvé des automobilistes sans vraiment chercher. Peut-être que c’est ça qui me parle autant, rien de prévisible, rien de su ni de sûr, c’est même pas la chance, c’est même pas l’élan. C’est la vie cependant. Alors à Vierzon, nous pourrions à nouveau acheter des Mister Freeze pour nous consoler, mais au moment où, il y a une voiture, jusqu’à Montluçon, puis une camionnette géniale, lui est accessoiriste et elle maîtresse d’école, on parle d’écriture et elle dit qu’elle ne le fait jamais, on parle de souvenirs de lecture d’enfances, et aussi de modes de vie, ça nous envole et nous réjouit. Enfin à la sortie de l’autoroute, il y a un homme qui nous déposera devant la porte, il veut bien faire le détour puisque de toute façon il teste sa voiture, alors ma grand-mère l’invite à boire l’apéritif, et c’est une drôle de rencontre qui se fait là.
J’aime cet arrêt impromptu dans la grande maison, le repas partagé, la tisane avant le coucher, les récits et le petit-déjeuner de rois le lendemain dans le jardin, avant de repartir. A nouveau l’attente, la frustration du garçon d’à côté qu’il me glisse et que je ne sais pas parer, un bouquet de fleurs pour peut-être un conducteur ? Mais personne. Deux heures et demie plus tard et trois kilomètres à pied, il y aura une voiture et le bonheur enfin de quitter l’ici. Nous déjeunons sous des arbres avant de faire une expédition au Aldi récupérer de quoi faire des pancartes. Sauts de puces, route nationale et panneaux pour chaque village. La route est belle, la route est belle, j’aime voir le paysage changer au fur et à mesure qu’on descend, la végétation se transformer, la destination se rapprocher. C’est C. qui cette fois nous attend au bout, mais quand nous arrivons dans la lumière horizontale de fin de journée, elle n’est pas encore là, un diabolo menthe et un demi-framboise à la terrasse d’un café pour patienter et battre des mains d’être arrivés.
J’aime bien cette incursion dans la vie de C., cette campagne-là, les plats préparés à six mains, le premier soir en suivant une recette, le second en l’inventant, les verres de vin devant la baie vitrée, et les soirées rythmées par le tintement du clocher. Au matin, il y a un mot à côté des croissants, nous sortons de notre longue nuit un peu éberlués. Un autre village dans les collines, nous marchons, au début sous une pluie d’été, puis au soleil, comme à chaque fois depuis le début de cette vadrouille d’été, je passe entre les gouttes, avec cette chance folle quand j’entends qu’à Lyon ou en Italie, il fait plutôt triste plutôt gris.


Dernier jour de stop, il faudra trois voitures pour arriver à la destination finale de la vacance, et pas plus de trois minutes d’attente au total, ça va presque trop vite, dites. Et puis il y a cette maison découverte début février que je retrouve avec bonheur, mais cette fois on peut planter la tente dans le jardin ; les enfants ne sont pas encore là, mais nous les rejoindrons bien. Nous sommes là pour le mariage, alors la veille encore, nous décorons une salle, nous emballons des présents, c’est tout doux comme environnement, tout mouvant et émouvant. Pendant le presque orage de la nuit, nous nous rapatrions dans la maison, le matin, nous préparons à douze mains au moins de l’humus et du taboulé pour cinquante personnes, on s’affaire, le dortoir à l’étage, les lits, ranger les affaires. M. me vernit les ongles de rouge, j’ose ? et je m’habitue doucement à cette couleur au bout de mes doigts. Et puis la cérémonie bilingue dans le jardin, l’émotion qui me prend alors que je me cache contre son épaule, et le bonheur de voir ces deux-là ensemble et ici, même si je les connais à peine, qu’importe, c’est bon ce lieu, et ces gens qui aiment tout autour. Et moi qui aime tout autant. Et qui aime qu’on s’aime, qu’on se poème à l’oreille, qu’on s’aime donc, qu’on s’hymne, qu’on se chante et qu’on se danse, l’un contre l’autre au son de l’orchestre balkanique, quand je vais le chercher pour lui dire, tu sais, quand on s’écrivait il y a si si si longtemps, un jour tu avais parlé de danse de salon, et déjà je m’étais dit, ah ce garçon…, et que nous nous mettons à valser là dans l’herbe, même si lui a oublié les pas tandis que je ne les ai jamais sus, il faut bien danser, il faut bien vivre, il faut bien applaudir le clair de lune, et en profiter, et tous les lieux qui nous accueillent, les champs et les forêts, les fleurs dans les cheveux et les bords de la Loire, les creux de la Bretagne et les routes d’Auvergne, les pierres des villages perdus et l’eau claire des rivières, les chances et les frémissements. On nous demande parfois pendant ce voyage comment nous nous sommes rencontrés, et si nous racontons en alternance, les réactions souvent se ressemblent : oh c’est fou, oh c’est beau, oh c’est fou comme c’est beau, et ah, je ne peux qu’approuver.


Le dimanche, le temps s’étire au petit-déjeuner, et nous repartons vers la salle et le jardin, ce sont les lendemains de fête, je pense à Léonard a une sensibilité de gauche, nous déjeunons des restes, racontons des histoires, et celle de la couronne en origami est mise en voix par Cl. alors que je fais bouger le papier. C’est si bon. Déjà, il faut repartir, laisser tout le monde ici, même lui, même lui qui m’emmène jusqu’à la gare, je rentre vers le nord, eux iront en Italie, ce sont des larmes bloquées dans ma gorge, j’ai pas envie, pas envie, quelle idée de quitter la route, pourquoi faire et comment faire, et lui, tout désemparé de ma tristesse, et nous, imbéciles dans la gare, j’ai mal à mes au revoir.
Dix heures après être rentrée, j’étais en piste avec des enfants, des petits à qui j’ai appris les couleurs et fait fabriquer des masques africains en leur parlant de Zigomar. Ici, j’essaie de renoncer à mes réflexes d’errance : dans les poubelles, je n’ai plus besoin d’attraper les cartons pour en faire des pancartes, et mon sac à dos de travail n’a pas de lanières où glisser mes pouces. J’ai repris les boulots, me suis dit que je préférais mille fois enseigner aux adultes qu’aux enfants, mais qu’à ceux-là par contre, j’adore lire des histoires. Ma binôme de jeudi a amené des albums qui m’ont profondément émue, et les gamins étaient géniaux.
L’autre jour, alors qu’entre le travail n°1 et le travail n°2, je préparais le travail n°3 dans un café perdu, quatre autostoppeurs ont débarqué, et je me suis demandé où s’arrêteraient les signes. Hier soir, bénissant la petite semaine, j’ai regardé lovers of the arctic circle. En fait, c’est peut-être bien s’ils ne s’arrêtent pas.