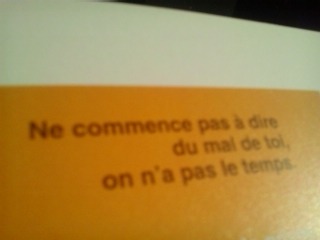[Aujourd’hui, je poste ici quelque chose qui n’est pas tout à fait la même chose que ce que j’ai l’habitude de poster. J’ai hésité à publier ce texte sur mon site professionnel, un espace où j’ai envie de faire du méta, d’écrire sur l’atelier d’écriture, mais comme ce lieu pour l’instant ne me plait ni ne me correspond tout à fait, je préfère poser ces mots par là. C’est le (long) récit d’un atelier d’écriture un jour de janvier 2015. Et aussi : des extraits des textes écrits ont été rassemblés là.]
lundi 19 janvier 2015
J’ai mal dormi. Mon atelier était prêt depuis samedi après-midi, mais mon inconscient l’a ressassé toute la nuit, réinventant des propositions qui, au milieu des pensées brumeuses, paraissaient soudain géniales et évidentes, et dont il ne restait que des lambeaux flous à 5h45, quand le réveil a sonné. J’ai la trouille. Comme à chaque fois avant un atelier avec un nouveau groupe, pour un nouveau projet, j’ai la trouille. Là, en plus, c’est particulier. Je sors un peu plus de ma zone de confort. Il s’agit d’animer un atelier dans une cellule de reconversion, avec des prépensionnés qui ont été licenciés en même temps que des centaines d’autres des célèbres usines Boël (elles ne portent plus ce nom depuis longtemps, mais c’est encore comme ça que tout le monde les appelle), usines de sidérurgie. Ca tient plus du récit de vie que de l’écriture ludique(-mais-pas-que) que j’ai l’habitue de proposer. J’ai la trouille, donc, j’essaie de la noyer dans mon thermos de thé. J’ai la trouille, mais je la crois nécessaire aussi, elle n’est pas insurmontable, elle est là, juste, le temps du semi-matin et du trajet en train. Je sais qu’une fois arrivée, une fois qu’on sera installés autour des tables, je retrouverai ma voix et mon souffle, je saurai dire.
*
Au fil du trajet, le paysage devient blanc. A la gare, la bibliothécaire qui m’a contactée pour ce projet m’attend et me conduit en voiture jusqu’à la cellule de reconversion. « D’habitude, elles sont installées à proximité des lieux – dans notre cas, l’usine – mais là, non, pas du tout. » Il faut dire que la cellule de reconversion, dans le brouillard et le blanc ambiants, semble n’être installée au milieu de rien. Posée là. Des préfabriqués collés les uns aux autres. J’ai un souvenir de collège qui me revient, quand on allait faire cours d’histoire-géo à ce qui semblait être le bout du monde, dans des salles glaciales. Ca ne manque pas ; quand on souffle ça fait de la fumée.
Les gens, à l’accueil, arrivent au compte-goutte ; je suis assise sur une chaise à côté de la bibliothécaire, un homme, R., vient vers nous, menton en avant, « On va écrire, là, c’est ça ? Mais pour faire quoi ? », et puis aussi, « Pfiou, jusqu’à 16h on reste aujourd’hui, quelle journée, diou, quelle journée ! ». La femme en charge du projet à la cellule de reconversion n’est pas là. Un peu bizarre de démarrer sans la personne qui fait le lien, qui a voulu ça, qui est capable d’expliciter les intentions premières. Mais comme le fait souvent remarquer le garçon d’à côté, tu as vécu un an au Kirghizstan, tous les imprévus du monde, maintenant, tu sais les gérer. Soit.
Bref, pour atteindre la salle, il faut sortir du bâtiment et monter des escaliers à trous casse-gueule avec la neige. On met le chauffage à fond. Je commence à bouger les tables, les rapprocher les unes des autres, faire un grand carré, être plus près – les installations en long empêchent d’entendre les visages, de regarder les voix, et réclament qu’une personne soit au bout, domine. Le carré m’est plus familier, plus familial. On va être prêts, ça va pouvoir, enfin, vous voyez, commencer. Alors ils entrent. La personne qui nous accueille à la cellule me dit qu’il faut qu’on veille à récupérer les bic, ils ont de vraies pattes, et puis elle leur dit, à eux huit, avant de nous laisser ensemble, soyez sages, et je déteste cette phrase, infantilisante à souhait. Ce n’est sans doute pas conscient, c’est sûrement involontaire, ça n’est pas malveillant, et pourtant, ça m’irrite, ça m’énerve.
Elle nous salue, la porte se referme. Nous y voilà. Sept hommes – un autre nous rejoindra l’après-midi, une femme. Tout emmitouflés dans leurs manteaux, écharpes, bonnets. J’avoue qu’il est difficile de faire autrement, il doit faire 2°C. Mais tout de suite, pour écrire, ça complique. De toute façon, il se passera un long moment avant qu’on ne prenne les bic en question, puisque ce qui frappe, d’abord, dans ce groupe, c’est le flot de parole après les premières minutes silencieuses. Comme si soudain, on ouvrait les vannes. On a présenté le projet à deux, puis j’ai expliqué l’atelier d’écriture, j’ai essayé d’aller au-devant des réticences, des mauvais souvenirs d’école, de la hantise de l’orthographe et des consignes non-respectées, je dis aussi, je suis française et j’aime tellement, tellement apprendre de nouveaux mots, alors ne croyez jamais que je me moque si par hasard je vous demande de répéter, et puis encore je veux bien vous apprendre des choses sur l’écriture, mais vous m’apprendrez tout sur votre expérience.
Et alors à partir de là, il y a cette parole qui coule, le tour de table qui commence et qui semble ne jamais finir, parce qu’il y a trop à dire, ça déborde de partout, jamais je n’ai vu ça, chacun rebondissant sur les mots de l’autre, un haussement de sourcils de ma part me donne droit à une frise chronologique et à un organigramme de l’usine, et puis on me dit, ah, il faut qu’on te fasse un lexique, parce que clairement, je ne connais ni leur langue, leurs sigles, ni leurs signes : CoCon, TCC, laminoir à froid, FI-BO, le coïl, la brame ou la paille (et là encore, ici même, est-ce que je les écris correctement, est-ce que je les retranscris de manière juste ?) Laborieusement, essayer de recadrer, j’hésite entre laisser faire, laisser dire, et garder en tête mon déroulé de la journée – je sais qu’il est important, ce moment où le groupe se fait, où chacun se dit. Dans ces premiers quarts d’heure, il y a déjà beaucoup, des souvenirs évoqués qui en révèlent mille autres, des gestes, des mimiques, des noms qui fusent, ceux dont on a oublié les visages, ceux dont le patronyme reste sur le bout de la langue ; et puis ils sont avides de curiosité, quel regard poserons-nous sur eux, nous qui ne connaissons rien à ce monde, moi je ne sais ni les marques rouges sur les tables de jardin de la région à cause de l’usine, ni les Noëls qu’on y passe, ni les cuves d’acier en fusion dans lesquels certains se sont jetés – on a dit accident, on a dit suicide ; ni la notion de camaraderie.
Et puis il faut bien écrire. Pendant mon master de français langue étrangère, j’avais fait mon mémoire sur l’écriture créative en classe de FLE, et je me souviens m’être longtemps posé la question de s’il fallait, ou non, apporter des œuvres littéraires dans les ateliers avec des gens qui n’en étaient pas familiers. Aujourd’hui, ça me semble évident, mais à l’époque, je sais que j’avais hésité : et si on bute sur les mots ? et si le texte proposé devient modèle à atteindre et intimide plus qu’il n’aide ? et si soudain, on se sent tout petit devant ces mots écrits et publiés et qu’on n’ose plus prendre son stylo – ce qui serait l’échec même en atelier ? Là, pour ma première proposition, j’ai emmené Perec, un extrait d’Espèces d’espaces, « De la difficulté qu’il y a d’imaginer une cité idéale ». Alors je le raconte un peu, lui, j’évoque les contraintes linguistiques et formelles, La disparition du E, on s’aperçoit que c’est la voyelle même qui permet à son nom d’exister. On lit le texte, et les réactions sont là, spontanées. Ah oui, même ce qu’il aimerait, il ne l’aimerait pas pour toujours ; et ce qu’il n’aime pas, parfois il aimerait. C’est comme si on ne pouvait jamais être tout à fait content de ce qu’on avait, et aussi que c’est difficile d’expliquer quelque chose et que ce soit toujours valable. On dit qu’il y a le mélange de lieux proches et lointains, imaginaires et réels. On remarque, avec un coup de pouce, que le texte suit l’alphabet, que c’est une drôle de façon de faire, D. en conclut je trouve ça beau, il ne sait pas ce qu’il veut, et je trouve ça beau.
Alors je leur explique pourquoi j’ai amené ce texte : parce que pour moi, l’usine, c’est un monde mystérieux, quelque chose qu’il n’est pas évident de définir, parce que ce n’est pas absolu. Voilà la proposition : tenter de dire l’usine par ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas, par ce qu’elle fait, et ce qu’elle ne fait pas. On reprend la structure, on l’inscrit au tableau. On évoque les possibles. Ils sont concentrés. Ils ont déjà la tête baissée, et le stylo sur la feuille. C’est une des rares fois où j’anime un atelier et où je n’écris pas. Je les regarde écrire. Je me tiens disponible si jamais il y avait besoin d’aide.
Mais ils se sont lancés à toute vitesse, sans peur de la page blanche, du stylo ou des ratures. C’est beau, de regarder un groupe qui écrit. Il y aura toujours quelqu’un pour finir avant tous les autres, pour poser son bic bruyamment à côté de sa feuille comme pour attirer l’attention, presque, quelqu’un qui dit, on ne va pas écrire un roman, quand même ? moi j’ai l’esprit de synthèse, alors je reprends, oui, pas comme avant à l’école, pas de nombre de lignes obligatoire, pas de panique, dis ce que tu as à dire. Petit à petit, chacun pose son stylo, se relit. J’évoque l’importance de la lecture dans l’atelier – j’en avais déjà parlé avant, bien sûr – et répète cette idée d’atelier, d’espace où les choses sont en construction – et eux le savent mieux que personne bien sûr –, que c’est un premier jet de choses, de mots, qu’on les accueillera avec bienveillance, là, ensemble, et s’il y a un volontaire – oui, même deux, même trois, même qu’il faut recadrer pour qu’ils ne se marchent pas sur la voix. Il ya tous les échos qui se tissent entre les textes, les mêmes idées qui reviennent sans cesse, l’usine est terrible mais pas que, une prison mais pas que, un cimetière mais pas que, un lieu désagréable, mais pas que, pas que, pas que. Et puis les perspectives différentes, l’usine n’est pas là pour un jour mais pour toujours, et juste après, d’une autre voix, l’usine ne travaille plus et c’est pour toujours ; mais tous les textes disent qu’on s’en remettra, oui, car l’usine n’est pas ma raison de vivre mais parfois si, l’usine est une partie de notre vie mais pas que, et j’aime quand quelqu’un sort du texte, sort de cette consigne proposée, et ce texte qui se termine par J’aurais aimé y rester quand même jusqu’à la pension, ce quand même bon sang.
Pause. On a rendez-vous à nouveau une heure plus tard. Quelques uns rentrent manger chez eux, ils habitent à cinq minutes à voiture, d’autres mangent un sandwich commandé le matin pendant le temps d’accueil – il y a donc des livreurs de sandwichs qui prennent les routes blanches qui mènent aux préfabriqués. On reste à quatre dans la salle, on bavarde, de l’usine et puis pas que, mais de l’usine surtout, quand même, parce que tout semble ramener à ça, toi tu es lyonnaise, ah oui c’est pas très loin de l’Italie ça non, à l’usine il y avait des tas d’Italiens, et puis c’est l’heure de reprendre, avec Prévert cette fois.
Ils connaissent mieux que Perec, on essaie de se souvenir d’un poème appris à l’école, peut-être ? Quelque chose avec un oiseau qu’on peint ? Ou un chemin d’école ? Oui, voilà, tout ça. Là, c’est un extrait de sa Tentative de description d’un dîner de têtes à Paris-France, un très court extrait de ce long poème en prose, alors on le lit et à nouveau, je les laisse s’en emparer et se le disputer, « ceux qu’on n’endort pas chez le dentiste », c’est parce qu’ils sont courageux ? qu’ils sont prétentieux, qui disent qu’ils ne vont pas avoir mal ? / ou bien c’est parce que ça coûte moins cher, c’est ceux qui n’ont pas d’argent / et « ceux qui coupent le pain avec un couteau », c’est ceux qui ne savent pas se tenir à table et qui ne connaissent pas les bonnes manières parce qu’on ne fait pas ça, normalement ? / non ! c’est ceux qui travaillent dans les champs, ils ont une miche de pain et un canif avec lequel ils partagent le pain à la pause et en donnent aux copains / mais un « dîner de têtes », on dirait un truc d’intellectuels ? pourtant, la description, c’est plutôt un milieu social moins élevé, c’est plutôt… en fait, c’est nous quoi, c’est un texte sur nous. Et c’est vrai, je leur explique qu’effectivement, à cet endroit-là, Prévert ne parle plus des gens présents au dîner, qu’il s’en éloigne, qu’il évoque les autres, ceux qui n’ont pas une vie qui les fait assister à des repas tels. Alors on parle de la phrase qui nous touche le plus, est-ce que c’est ceux qui crachent leurs poumons dans le métro, ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire, ou bien ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d’autres écriront en plein air que tout va pour le mieux ?
Et alors on en vient à nouveau à l’écriture ; comment est-ce qu’on dit les gens et leur rapport à l’usine, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur, qu’ils la connaissent comme leur poche ou qu’ils n’y aient jamais mis les pieds ? Tous les gens évoqués le matin même dans les anecdotes et les récits, comment les raconter ? A chacun d’écrire sa liste de ceux qui… A la lecture, il y a parfois un celles qui qui vient troubler la répétition, celles qui attendent impatiemment leur retour, comme des femmes de marin.
A la lecture, il y a aussi parfois un verbe qui n’en fait qu’à sa tête, un croivent, ou un voyent, ceux-là je les laisse, je corrige les erreurs d’orthographe, mais je veux rester au plus près de leurs structures grammaticales, de leur parole première, ceux qui disent ce qu’ils voyent, ceux qui voyent et se taisent. Il y a des regrets, ceux de l’usine qui m’ont oublié à l’extérieur de l’usine / ceux qui envoient faire un travail mais qui ne savent pas le faire eux-mêmes, de la gratitude ceux qui m’ont mis au monde / ceux qui m’ont enseigné / ceux qui m’ont battu à l’école pour réussir / ceux qui m’ont accueilli à l’usine la première fois et puis de la poésie douloureuse ceux que l’on ne remercie pas pour leur labeur / ceux que l’on remercie sans raison. Il y a derrière chaque phrase une histoire, tu sais Amélie, quand je dis ceux qui aiment les animaux on dirait que ça n’a pas de lien avec l’usine, mais en fait si, parce qu’il y avait cet homme, tous les matins il venait, comme nous tous, et tous les matins, à la machine où on pointait, il y avait dix, quinze chats errants qui l’attendaient, je te jure, ils l’attendaient, et tous les autres d’acquiescer. Combien d’histoires qu’on n’aura pas le temps d’écrire, combien de gens, de souvenirs ?
Dernier temps d’écriture ; on essaie de définir le monologue intérieur, ce que c’est, un peu de l’introspection, en fait ? quand tu réfléchis à toi et à ta vie ? ; puis il y a une liste de questions dans laquelle ils en piochent une, le texte que je leur propose d’écrire y répond alors qu’ils s’imaginent à l’usine. J’aime le résultat de cette consigne, même s’ils s’éloignent de la forme que j’avais imaginée : nous aurons les descriptifs des rituels, les gestes du métier, ou bien un retour sur soi, dont l’usine est presque absente. Il est tard, nous n’avons que peu de temps et je veux que tout le monde puisse lire, alors je propose un tour de table silencieux, nous nous efforcerons de ne pas rebondir sur chaque texte, nous lirons un à un, en cercle, nous enfilerons ensemble sur un collier ces réponses à des questions intimes et extérieures.
[Qu’aimes-tu ?]
J’aime ce que je fais, je m’occupe des travailleurs, de leur sécurité, de leur bien-être, qu’ils soient heureux et non stressés au travail, qu’ils retournent chez eux avec l’envie de revenir demain, car demain est un autre jour, de les voir souriant, car chaque jour est différent, j’aime écouter : leurs plaintes, leurs tristesses, leurs joies, qu’ils me parlent de tout ce qui ne va pas dans leur travail avec leur chef, leurs amis, leur femme, leurs enfants, leurs craintes pour leur travail, si l’usine ne va pas fermer !! avec tout ce que l’on entend ! en somme leurs misères, car le fait d’en parler, ça les soulage et ils repartent avec le sourire, pour revenir le lendemain avec l’espoir d’un surlendemain. G. C.
[Qu’est-ce que tu fais ?]
C’est la question que m’a posée mon chef ! Alors je lui réponds « ben je fais mon travail », par cette question, il vérifie quand même si celui-ci est fait correctement. Alors me viennent à l’esprit toutes les données de mon travail, est-ce que j’ai bien pris les mesures ? les mesures de sécurité ont bien été prises ? ma tenue est-elle correcte ? après toutes les vérifications, je constate que tout est bien correct. Après mûre réflexion, j’ai constaté que sa question ne concerne pas mon travail, mais son intérêt pour ma personne, je n’avais pas bien compris sa démarche, et l’en remercierais plus tard. A. M.
[Où vas-tu ?]
Un jour, alors que je me levais pour aller aux toilettes, mon collègue m’interpela et me demanda : « Où vas-tu ? » J’étais un peu interloqué par cette question et cela m’a fait penser à mon fils lorsque c’était moi qui lui posais la même question. J’ai fait mon introspection et me suis rendu compte que je m’immisçais dans sa vie de façon tout aussi brutale. Sauf que j’essayais de me justifier à l’égard de mon descendant. En effet, je m’inquiétais beaucoup pour mon fils. Je voulais savoir où il allait et qui il allait rencontrer. Comme le dit le proverbe : « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». A moultes reprises, j’ai pu constater que les relations bonnes ou mauvaises avaient souvent une incidence sur la vie future. C’est donc pour influer sur sa vie que je me permettais cette question. Je me défendais, en tant que père géniteur et surtout en tant que personne responsable de l’avenir de son enfant. Dans la même mesure, je m’entends encore lui demander : « Qu’est-ce que tu fais ? » J’en conclus que mon collègue n’a certainement pas pensé mal et que c’est peut-être dans un esprit de protection qu’il a agi de la sorte, comme je le fais envers mon enfant. J.-N. D.
Voilà. Il reste dix minutes avant la fin de la journée. Je voudrais dire encore mille choses. Eux aussi. Je leur demande de classer sur une feuille les thèmes que j’ai imaginé traiter lors des séances suivantes ; être au plus près des envies. Et puis un tour de table, est-ce que ça a été ? est-qu’il y a quelque chose que vous voudriez dire ? alors il y a R. qui le matin me demandait écrire, mais pour faire quoi ? qui lance moi j’ai la tête comme ça avec les mains aussi larges que quatre fois la dite tête, mais c’est bien, d’être emmenés dans ses souvenirs et puis j’ai l’impression qu’on pourrait écrire quatre livres au moins et encore tu nous permets de trouver un fil conducteur à tout ça, c’était pas gagné ou alors c’était pas ce à quoi je m’attendais mais j’ai passé une bonne journée, aussi je découvre les autres, on était tous dans la même usine, mais à 3000, comment tu veux te connaître, alors aujourd’hui, j’ai appris des choses, et j’ai aimé ça.
Moi aussi, je sors épuisée. La neige s’est transformée en gadoue. J’ai dans mon sac un tas de mots nouveaux, et un horizon que je n’imaginais pas. J’attrape le train du retour. Je feuillette les classements qu’ils m’ont proposés. A vue de nez, comme ça, on évoquera le lien entre la famille et le travail, l’équipe les collègues et la hiérarchie, l’usine et ses traces. Contrairement à ce que j’avais imaginé, on ne parlera pas, ou très peu, de revendications et colères. C’est qu’ils ont autre chose à dire, à la terre entière.