Un vendredi soir, nous buvons une bière dans un bar dont j’aimerais qu’il devienne le bar à côté de l’appartement d’à côté, et plus tard en descendant les rues, nous découvrons une librairie parfaite pour lui ; pourtant, c’est moi qui en sors le sac plein de bouquins, c’est qu’en ouvrant de petites choses dont les titres m’évoquaient grand, j’ai lu Sur la rive où je vis, j’aimerais qu’on ne distingue ni l’écriture de la vie, ni la vie de l’amour. Alors forcément.
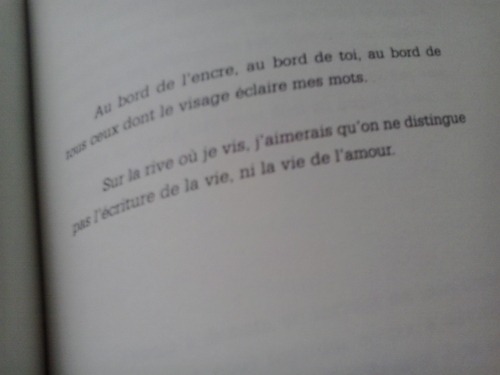
Je ne sais pas si je pars pâtisser à la cuisine pour me laisser un moment pour écouter des podcasts ou si c’est l’inverse : avoir des podcasts à écouter pour me donner l’occasion de préparer des choses à grignoter au goûter. En tout cas, je ressors des recettes qui m’évoquent l’automne, une tranche de pain d’épices recette de ma grand-mère avec un chaï latte en lisant le dernier roman de Mauvignier, une tarte au citron, un gâteau aux carottes et aux noix – le petit garçon avec lequel j’habite en en redemandant ce matin a dit, tu pourras en refaire pour mon anniversaire ? C’est en juin, mais j’aime bien. En attendant, j’ai réussi à en sauver trois parts, pour celle qui nous prête sa voiture et ceux qui me prêtent un clavier – de quoi dégourdir mes doigts et peut-être un peu ma voix.

L’emploi du temps du moment est un peu trop plein, il manque quelques heures à nos matins. Pourtant, quand le garçon d’à côté n’est pas là – et c’est le cas souvent, ce sera un automne à creux, dans le matelas quand il s’en va et dans le ventre aussi, au fond des yeux – je déplie le tapis de yoga pour retrouver des gestes que j’ai aimé faire, un corps que j’ai aimé sentir. Quand les journées battent leur plein, j’essaie de ne pas me sentir débordée, de m’occuper d’une chose après l’autre, mais quand même, cette impression de courir un peu partout, même si c’est pour tout ce que j’aime. Il y a deux petites Italiennes le mercredi après-midi qui veulent bien faire avec moi des dictées zéro faute en mangeant des grains de raisins ; des ateliers d’écriture le soir, avec ce groupe que je me faisais une joie de retrouver, et le bonheur aussi d’y accueillir de nouvelles têtes et de voir que tous se mêlent, et que cette ambiance-là est parfaite ; des réunions pour de nouveaux projets, dans un musée qui me fascine d’autant plus que je le découvre par le biais d’une guide passionnante, ou dans un établissement scolaire qui ressemble à un château, et dont les couloirs me perdent. Mon agenda s’arrête le 4 janvier 2015, j’ai ouvert un document sur l’ordinateur pour la suite, pour ne pas oublier ce qui se passe après.
Je me rends compte que l’air de rien, j’ai oublié ce qui s’est passé avant. Avant avant, avant il y a longtemps, quand je n’écrivais pas le quotidien de si près. Je suis allée à Lyon l’espace de quelques jours, le temps de pas grand-chose. Il fallait vider une chambre, et ne pas balbutier devant l’émotion de mon père lorsque je lui ai dit que ça me ferait nécessairement bizarre de revenir dorénavant dans une ville aux appartements que je n’ai jamais habités. Je croyais n’avoir presque plus rien dans cette chambre-là, pourtant j’ai passé des heures à remplir des cartons de livres aimés et précieux, et à étaler dans la chambre d’à côté tout ce que j’avais à donner pour les gens qui passeraient. Faire des heureux pour ne pas trop me faire bouffer moi, ce plaisir d’offrir, de me délester des choses, savoir que les jeux auxquels nous jouions gamines avec mes sœurs, le dix de chute, les mystères de Pékin, le Cluédo, raviraient d’autres enfants et égaieraient d’autres dimanches après-midi ; que cette tunique du Burkina que je n’ai jamais portée rejoindrait la collection qu’un homme en fait, que ces colliers colorés auraient d’autres vies, que ce duvet dans lequel j’ai tellement dormi verrait d’autres tentes, peut-être d’autres pays. Les gens passent, ils sont nombreux à piocher, et puis il y a cet homme qui feuillette cet imagier pour les tout-petits sur lequel j’avais beaucoup travaillé une bonne partie de mon été parisien à Flammarion, il le trouve chouette et répète ça au moins cinq fois, j’aime à savoir que son petit-fils le gribouillera. La veille avec mon père, nous avions jeté dans la benne (j’avais écrit *belle) devant l’immeuble mes cours de collégienne, de lycéenne, d’étudiante, j’avais une écriture et une présentation de petite fille sage, sans accroc, sans remous. C’est plus tard que c’est devenu un peu plus flou.
Mais Lyon, c’est aussi les copains, K. et ses diablement chouettes projets, Lène et les conseils bouquins, A&L qui me racontent la Slovénie où ils sont allés cet été sur nos conseils, passer du temps dans la maison d’A&A où nous étions en avril. Et devant leur enthousiasme et les souvenirs communs, je me dis que c’est en train de devenir une de mes plus grandes passions : mettre les gens en lien, dire à ceux que j’aime ceux qu’ils pourraient aimer, ceux qu’ils devraient lire, qui ils pourraient contacter ; donner des coups de pouce, rencontrer des gens pour partager des expériences, ou pour faire des projets. Et observer ensuite ce qui se noue. A&L nous montrent leur jardin collectif et les tournesols qui font le double de notre taille au moins, et je vélove dans la nuit. Le lendemain, un chocolat dans ce café que j’ai tellement squatté et une partie d’un nouveau jeu dans le jardin du musée des Beaux-Arts. Le ventre tout rond d’une amie, mon ciné préféré pour un film dont les quatre premières minutes me coupent le souffle (mais la suite m’embête un peu), et les lassis parfaits du restaurant indien. Il y a Lotte qui sonne à l’interphone et que je fais monter avant de la serrer longuement dans mes bras, nous passons l’après-midi à manger une gigantesque salade en terrasse en parlant en continu, comme toujours quand on a si peu de temps – je me souviens du voyage au Laos, des silences qu’on avait alors, mais depuis, plus tellement, les retrouvailles sont toujours trop brèves pour laisser le temps aux mots de se suspendre. Un chassé-croisé à la gare, je l’embrasse, et le garçon d’à côté arrive dix minutes après son départ.
A lui, je lui montre ce que j’ai retrouvé de mes vies d’avant, un livret d’évaluations de primaire, des collages immenses, les journaux du lycée, quand j’étais rédac’chef, qu’on faisait des réunions le lundi soir au sous-sol et que j’écrivais des éditos politisés, ce que je serais bien en peine de faire maintenant – et il dit, ah, ça c’est toi aussi. C’est à mon tour de dire la même chose quand je le vois écrire une semaine plus tard dans une liste d’adhésion son adresse de militant – ah, ça c’est toi aussi, tu es aussi là et là et là, et là où je ne te connais pas encore, et ici où je veux bien te suivre, et ailleurs où tu me surprends toujours, et qu’est-ce que ça veut dire, connaître quelqu’un par cœur ? Est-ce possible, seulement ?
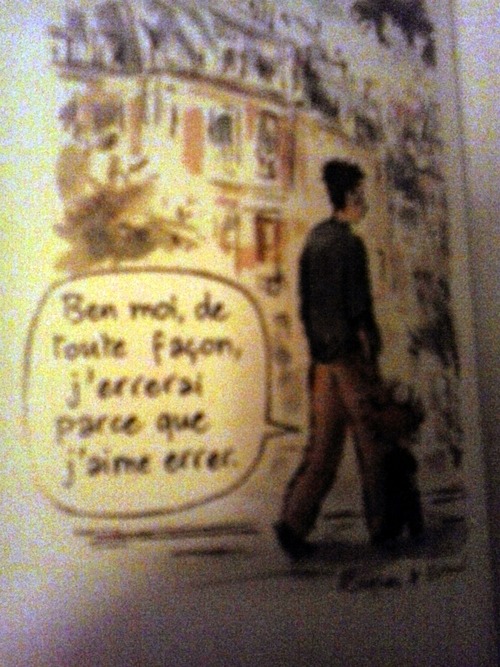
Il y a des tas de questions qui n’ont pas de réponse, mais au moins il y a ses mains bien à plat sur mes épaules quand je joue un tout dernier morceau sur l’orgue électronique qui m’a accompagnée toutes ces années, même si ça calme à peine les tressautements.
Dans le train qui nous ramène à Bruxelles, je me sens bizarrement vidée et fragile, sur un fil, et j’ai besoin de retrouver – c’est flagrant et immense – une chambre à soi. Au retour, on passe chercher des classeurs dans un cabinet d’architectes, on mange une frite, et on va boire un verre en terrasse pour profiter de l’été indien. On rentre, vite, vite, allez.



L’été indien en sortant de l’atelier d’écriture et en rejoignant dans la nuit l’amoureux au cœur de la ville en pleine discussion sur le revenu de base avec des inconnus, l’été indien en dévalant la rue dans le soleil pour aller chercher un cadeau à lui offrir un peu plus tard alors qu’il avait déjà presque deviné ce que c’était, l’été indien toujours avant d’aller voir Ch. sur scène dans une toute petite salle, et cette chanson qui me reste ensuite tout le long de la nuit et de la semaine, tant pis si la route est longue nous ferons le tour du monde, et ce film quelques jours plus tard qui débloque des choses, qui nous fait mettre les envies en mots (mais pas encore en continents), et imaginer la suite. Souvent, j’aime comment un podcast, un film, une lecture viennent ensuite alimenter des heures de discussions et de débat, des heures de radeau-tage, comment on peut parler de tout dès qu’on a nos peaux l’une contre l’autre, comment tout est plus simple alors. Un jour, je vais voir le musée des relations brisées, et je sens quelque chose se fendiller en moi, une certitude, peut-être. Je ne lui en parle que plus tard, quand il y a la fatigue, les terrains d’entente à trouver, 5h du matin, je veux lui parler, et nous parlons, je ne sais plus ce que nous disions ni ce que nous dormions. Le lendemain matin, il est parti, j’ai de la brume plein les pensées et ma coloc s’étonne de me voir boire un café. Depuis hier, il fait un peu plus froid, et un, deux, toi.
Rue de Bosnie, il y a un repas de presque au revoir, même si je suis à nouveau avec C. le lendemain, c’est l’avant-première de before we go, mais c’est un before you go en fait, puisqu’elle qui repart à l’autre bout du monde sans bien savoir jusqu’à quand. Un dimanche à la mer, le plus joli des carnets, et un bébé de pas encore cinq mois qui s’endort dans mes bras en buvant son biberon. Sur le miroir de la salle de bains, reste écrit au rouge à lèvres je vous aime, avec trois points d’exclamation.
