Dans un texte, une étudiante écrit « la mémoire tamisée » pour dire les trous de mémoire, et mon feutre vert fait une vaguelette sous l’expression. Je lui dis à quel point c’est beau, ces trois mots ensemble, je lui demande, est-ce que je peux te les emprunter ? Devant son oui, je lui emprunte donc, et je pense à ici, aux phrases que je laisse, entre deux gorgées de thé encore chaud, elles aussi passées au tamis de la mémoire ; à jeter : cailloux et tessons, ce qui gratte et qui frotte, ce qui réouvre plaies et blessures mal ou jamais cicatrisées, ce qui coup de poigne le ventre et broie les épaules. À garder : le reste. Travail minutieux de tri, sur un marque-page dont je me rappelle le bleu vif, C. m’avait écrit il y a déjà longtemps tu es une orpailleuse. Je crois qu’enfin je comprends.

Depuis quelques jours, le ciel est blanc comme à Bruxelles, et depuis le canapé du salon, je ne vois que les arbres qu’agite le vent. Parfois le matin, me manque cette ville soudain, samedi avec le blues au cœur j’ai marché ici, une vieille dame m’a expliqué combien elle regrettait avoir suivi son mari en Suisse, surtout depuis qu’il l’avait quittée. Je suis rentrée encore plus chamboulée. Alors j’attrape les livres de la bibliothèque – je m’y suis inscrite pour dire, regardez je m’installe – et je me roule en boule, laissez-moi plonger dans Anne-Laure Bondoux ou Alice Ferney.

Je n’ai jamais appris la neige, mais là c’est le moment. Il faut du temps, c’est froid ça glisse c’est mouillé, mais quand je vois l’énergie décuplée du garçon d’à côté, je me dis que je dois persévérer. Qu’il y a là sans doute quelque chose qui m’échappe, mais qu’un jour peut-être j’apprécierai. En attendant, je rajoute des crampons sous mes chaussures et des collants sous mon pantalon, j’avance à demi-pas à demi-mots, ne m’en demandez pas trop. Une fois les raquettes enfilées, je me sens plus stable, oui, un peu moins effrayée ; c’est que ça ramène au corps et on sait bien que je n’ai guère confiance en lui, mais ça aussi ça s’apprend, petit à petit. En tout cas, bien sûr que c’est beau, mes yeux essaient de distinguer les sommets, je lis Paolo Cognetti et ses Huit montagnes pour m’en imprégner et je repense à Giono – était-ce Giono seulement ? – qui parlait de jaune d’œuf sur du sucre glace pour dire les montagnes et le soleil qui tombe derrière. L’image me revient peut-être parce que l’heure de préparer des crêpes pour la Chandeleur approche. Le lendemain, je reste travailler non loin du poêle du chalet en bois, il y a la promesse du funiculaire pour midi, le repas partagé en haut sur la terrasse, et la redescente à pied, des mots dans les poches, les souffles, les voix, les pauses. En bas, on déballe le cake aux fruits secs cuisiné avant de partir, on boit du thé très chaud. Bien sûr que c’est beau.




Quelques week-ends plus tôt, il y avait des retrouvailles dans un autre lieu, lui aussi bardé de blanc, des amies de longue date, longue distance, longue haleine, retrouvées là tout à coup. C’est ce que ça permet, d’être plus près, de se rejoindre comme ça, pour un cocon de jours, les discussions à deux à trois à six à côté, les ventres arrondis les espoirs et les féminités. Quelques week-ends plus tard, il y a ces minutes à marcher de nuit dans la neige à nouveau, à la recherche du refuge forestier qui accueillera notre feu et notre fondue. « Ah, je crois qu’on est perdus », dit l’un, me rappelant ainsi tout à coup une pièce de théâtre – la première vue ici.
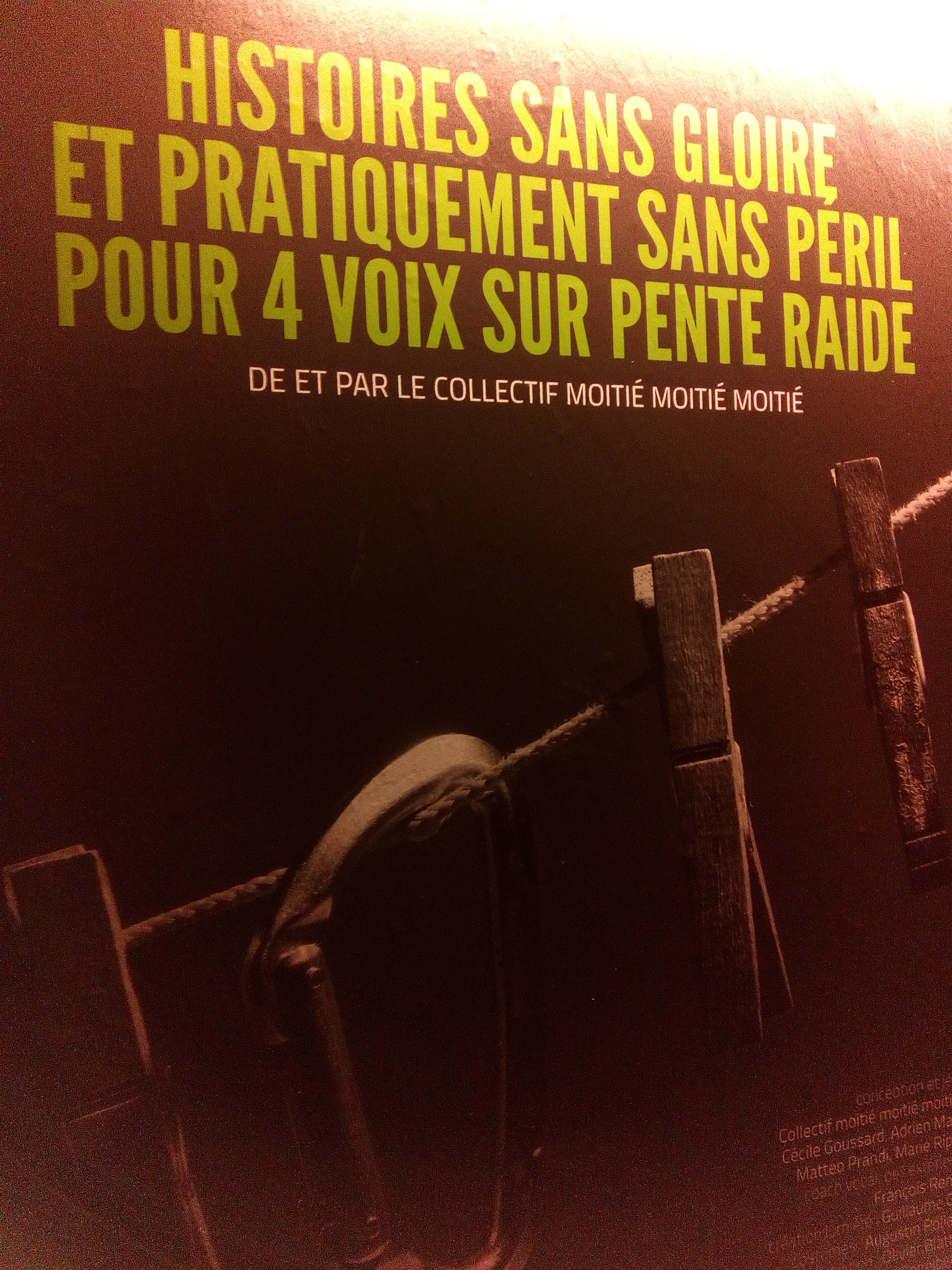

Je m’imprègne de l’accent des gens et je collectionne ces nouvelles expressions, quand on me dit alors que je m’apprête à prendre le train, « bonne rentrée ! », je reste une seconde interloquée avant de remercier. Quand on me demande si j’ai besoin d’une fourre, et une seconde plus tard, « ou plutôt d’un cornet ? », je ne sais que balbutier. À Genève, je signe mon premier contrat à durée indéterminée, et je crois qu’il n’y a bien que dans ce cadre-là que j’en suis capable : celui d’une coopérative sans hiérarchie, où je suis en charge moi-toute-seule de ramener mon propre salaire. Dans les bureaux, des choses s’esquissent, des idées, j’imagine les synergies possibles, ce qui pourra s’inventer.
Pendant deux jours, je réécris un manuscrit né il y a sept ans, ça vient d’un coup parce que l’échéance est là, je travaille encore bien trop souvent comme ça. J’ai le cœur battant quand je sors de la boutique de photocopies – j’ai dû prendre le train pour y arriver, découvrant ainsi ce que c’est que d’habiter dans une petite ville ! – et encore plus quand la guichetière de la poste tamponne mon enveloppe. Les dés sont lancés, je ne veux déjà plus y penser. Je profite d’être là pour marcher jusqu’à la bibliothèque féministe, je me dis que ce serait bien que je parle à des gens, mais j’ai tant de mal à faire ça, à être celle qui déclenche. Je me dis que le fait d’emprunter un bouquin amènera bien la discussion, mais tout le lieu est en autogestion : je peux me faire une carte de prêt toute seule, j’y inscris date et titres, et je repars, un merci au revoir timide et dans le jour qui tombe, je ris de moi. Je reviendrai et les choses se feront, petit à petit, je suis celle que je suis, acceptons-le pour une fois.

Un jour, je pars ; il y a des éboulements sur la voie alors je prends un covoiturage dans lequel ma voisine fait le même métier que moi – quel hasard, quel hasard ma foi. Je débarque chez ma lumineuse, son amoureux et leur petit bout tant grandi. Il faut quelques demi-heures pour l’apprivoiser, et je regarde leur jolie vie avec émerveillement, lui assis sur le bar, les pieds sur le plan de travail, avec son père qui lui tend le sel pour qu’il assaisonne la soupe, nos verres de vin et gnocchis fabriqués alors que l’enfant dort. J’aime bien débarquer comme ça pour une soirée, le lendemain en me laissant à la gare, elle me dit : tu sais que tu peux rester plus, aussi. C’est vrai qu’on n’a pas tout le temps de se dire, il faut abréger et sélectionner, entre la ludothèque et le marchand de fruits et légumes pour trouver de la sauge pour le dîner – finalement ce sera du thym de la terrasse, et ce sera très bien. Avant de se séparer, on a fixé des dates pour qu’eux viennent tout un week-end, dans cet appartement ou dans un autre, ouf ! Je continue ma route jusqu’à Montpellier et je fais écrire les étudiant.e.s, réfléchir à ce que c’est que de faire écrire, justement. C’est leur tout dernier jour de cours (de la vie ?!) et ça me ramène en arrière, quand on était aux prémices de quelque chose – mais est-ce qu’on n’est pas, toujours, aux prémices de quelque chose ? Je laisse la question en suspension et je vais boire une bière avec des gens qui me font dire que le monde du FLE est décidément tout petit.
J’arrive chez K. tard mais avec des tartes achetées pour le dessert. J’aime bien cette régularité qu’on réussit à avoir ensemble, sans doute que toutes nos sessions de boulot et de motivation en ligne y sont pour quelque chose, mais quand on se retrouve on peut se raconter ; c’est comme continuer une conversation jamais tout à fait interrompue.
Le lendemain dans un garage, j’inspecte l’intérieur de trois cartons laissés là il y a quelques années mais pas tant, tout ce qui reste de ma vie d’enfant. Il faudra trouver un moyen de les ramener jusqu’au nouvel appartement. Dans le cabinet d’une médecin, je raconte ; il faut toujours que je réfléchisse une seconde ou deux pour bien prononcer embolie (c’est que j’ai tellement dit embellie, que je ne sais plus quel mot est le bon) et à chaque fois, les yeux grand ouverts et les sourcils froncés de la personne en face, comme une piqûre de rappel, ah c’était donc grave, ah c’était donc vrai.

Quand je rentre, j’aime me laisser glisser contre son corps à lui, tiens tiens te voilà tiens-moi comme je tiens à toi. Et puis je dois déjà repartir. C’est comme si j’avais pris sa place à lui, je suis celle qui file sans cesse, une machine à laver en train de tourner, une autre étendue, mon sac à dos à fermer, un sac de couchage accroché sur le côté. À Lille, c’est M. qui me récupère et m’embarque presque aussitôt à un stage de chant – et pendant quatre heures, quel plaisir de chanter à nouveau ensemble – une façon d’être avec des inconnu.e.s même s’il y a C. comme une surprise à laquelle je ne m’attendais vraiment pas ! Le soir même, on fait une grande soupe et on a des invité.e.s surprise, j’aime voir cette maison et cette vie de quartier qui semble bouger tout le temps, les enfants qu’on récupère chez une voisine qui en avait sept en même temps. Ça fait de joyeuses farandoles.
Après le souper, on prépare encore la formation qu’on s’apprête à donner tous les deux ; première fois et grandes inspirations, mais si d’habitude je suis stressée, de voir M. l’être aussi me détend tout à coup et me rend confiante et rassurante – allez comprendre. À deux, on apprend à se compléter, et aux pauses on réajuste, le soir avec un verre de vin, a-t-on fini de préparer demain ? Un chronomètre sans cesse dans la tête, on essaie de maîtriser le temps qui va trop vite, mais à la fin, quelqu’une nous remercie pour ça – d’être allé.e.s au bout de ce qu’on voulait leur proposer. On sort de là crevé.e.s mais avec aussi beaucoup de nouvelles idées à explorer, d’albums jeunesse à lire et de choses à imaginer.
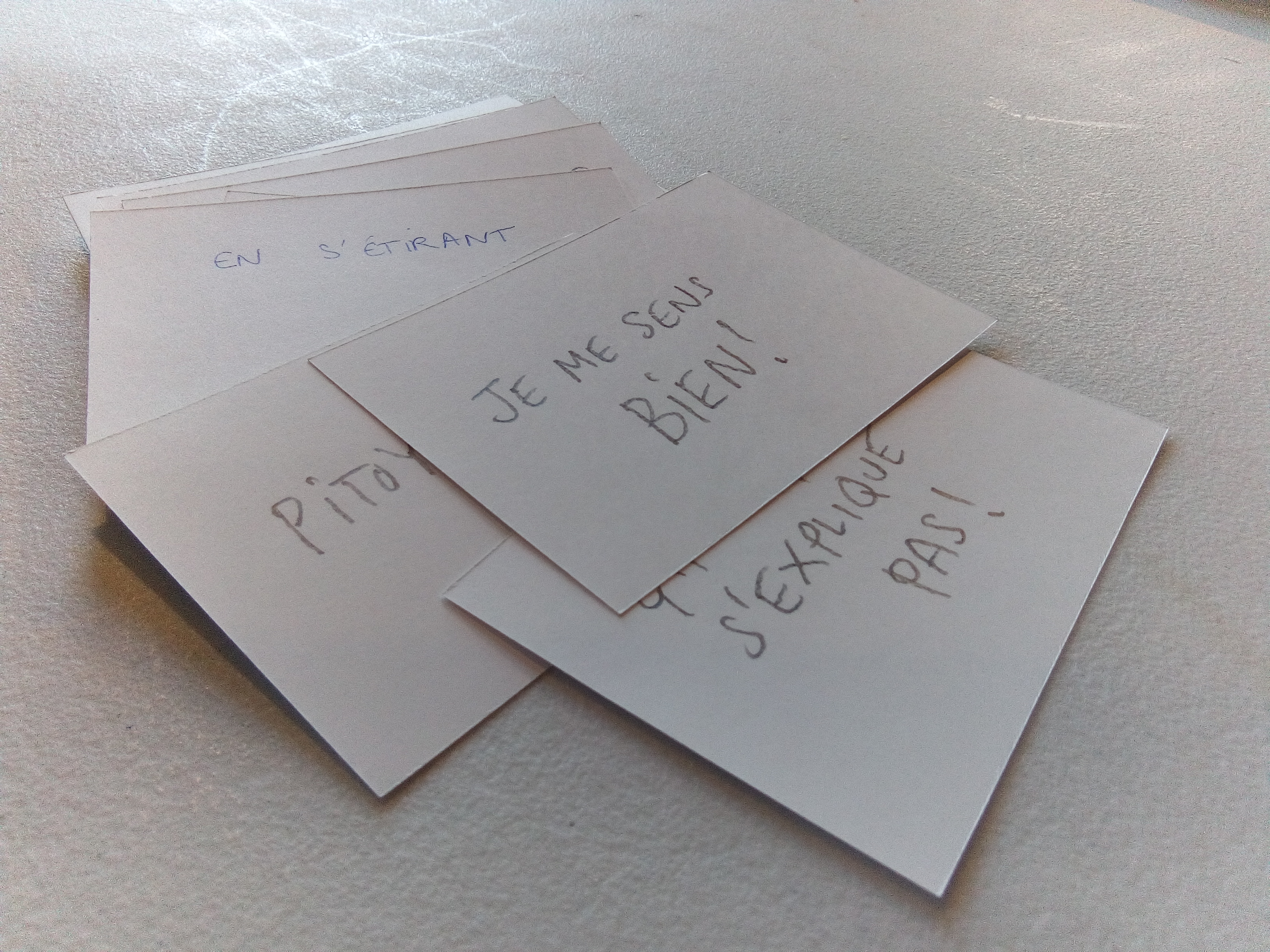
Au moment où je me dis, « ah tiens c’était la dernière proposition de boulot avant longtemps, que va-t-il se passer maintenant ? », je reçois un mail qui me demande si je suis libre la semaine suivante – oui – et celle d’après ? – aussi ! – un énième coup certainement de mes 47 bonnes étoiles.
En attendant, je file vers ma belle Bruxelles, c’est qu’il serait dommage d’en être si près et de ne pas en profiter. Les petites journées sont si vite remplies, je retrouve l’appartement de C., où nous dormons toutes les deux sur les canapés – tu te souviens de cette nuit sur la terrasse ? Il avait plu au matin, on était rentrées, ce que ça fait de se raconter. Il y a une gaufre avec Hanneton, quelques chansons esquissées sur le clavier du piano de C*. La lumière dans l’appartement de Mél, les histoires d’A., un petit-déjeuner avant l’aube avec M*, un passage dans ma librairie, et un au marché de vrac faire un petit stock de fruits secs, et de chocolat. C’est un peu la course, les journées qui n’arrêtent pas de se re-planifier et je voudrais passer plus de temps avec chacune ; c’est étrange aussi, de revenir là où on n’habite plus, ça ne m’était plus arrivé depuis longtemps.
Retour en Suisse, je suis épuisée de cette semaine dense et je m’endors en travers du lit. Le soir, le garçon d’à côté me rejoint à grand peine puisque j’avais fermé le mauvais verrou – toutes ces minuscules habitudes à intégrer. Des maladresses, des fatigues des débuts, quand tout est neuf et demande de la concentration – le jour où la machine à billets décide de ne pas me rendre la monnaie, où je rate mon train, ne trouve pas l’arrêt de bus à ma correspondance, me fais engueuler par le chauffeur, je fonds en larmes et me trouve bien bête de faire tant de cas de si peu de choses, au fond. Heureusement, quelques jours plus tard, ma chère J. est de passage pas loin, je la rejoins dans une grande maison dingue aux livres partout et aux immenses baies vitrées, nous y mangeons thaï et je rencontre de belles personnes – de celles qui soufflent qu’il y a bien sûr du beau à construire ici.
Et puis commence ce premier travail ici, pour de vrai. Pendant quinze jours, les réveils et les départs bien avant le jour, chaque matin dans le train si je peux, je choisis, côté lac. Côté lac, même s’il reste des copies à corriger, un regard jeté entre chaque, côté lac. Quinze jours à découvrir un nouveau public – ici, les apprenant.e.s ne disent pas les mots à voix haute en anglais pour vérifier s’iels ont bien compris, mais en allemand. Ça me donne envie de replonger dans cette langue. Il y a quelques étudiant.e.s que j’embarque dans des ateliers d’écriture et qui débordent de créativité, et ce sont ces souvenirs-là que j’ai envie de garder. La grammaire inductive ne convient pas à tout le monde mais j’affirme des choix, et je tremble aussi parfois.
Ma sœur débarque pour quelques jours, pour quelques tasses de thé à bavarder sur le canapé. Des pas jusqu’au lac mais pas beaucoup, c’est qu’il fait si froid que ça nous enveloppe, elle me montre une ou deux comptines quand je lui parle des prochaines animations avec des petits vraiment tout petits. Elle est si belle, ma sœur, quand elle parle des enfants dont elle s’occupe, quand elle imite voix et mots, quand elle raconte. Qu’elle soit là, ça rend les jours plus fluides, c’est que cette fois, le garçon d’à côté n’est pas là et dans cet endroit où je ne connais encore personne, je ne sais pas tout à fait quoi faire de moi.
La vie a le goût de pain d’épices et de mandarines, et prend tout à coup des teintes ensoleillées aux coups de fil de Mam ou de Lotte, et en raccrochant, je me dis que j’ai hâte du moment où nous pourrons faire nos premiers semis. En attendant, les petites graines de la suite, oui, semis, semis, semons.

