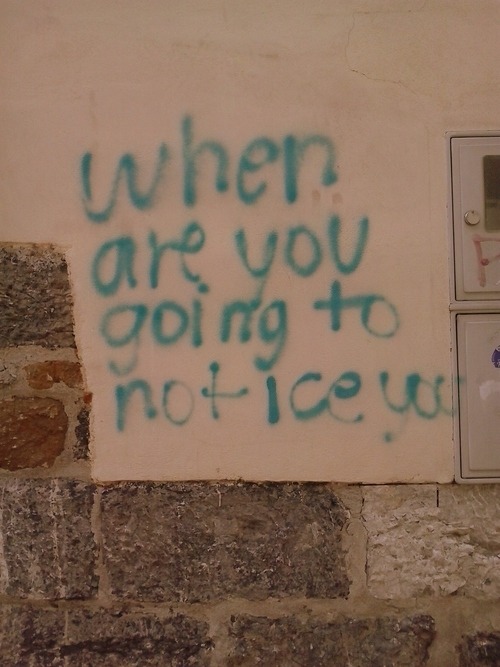La vie ce printemps-là, c’est parfois trop de bruit tout autour, trop de monde, trop de gens. Parfois le bingo de la soirée électorale pour essayer de garder le sourire quand même mais ça ne marche qu’à peine ; parfois les larmes devant la maison communale d’apprendre qu’on ne pourra pas glisser un bulletin de vote dans l’urne sans que ce soit même de sa faute ; parfois l’angoisse, parfois la colère. Mais parfois seulement.
Un matin, ma mère m’a appelée et puis elle était là en haut de l’avenue, je la voyais depuis la fenêtre de l’appartement et je l’ai guidée jusqu’à notre 4ème étage. Le temps était dégueulasse tout le long, alors on a surtout écouté des podcasts, bu du thé, trainé dans des magasins de tissus et partagé des souvenirs devant un burger végétarien. Tant pis la pluie et c’était bien.
Et puis quelques jours plus tard, c’était à moi de partir, j’ai préparé le week-end à Paris avec un peu de nostalgie. C’est que j’ai relu des morceaux des Mains dans les poches, des bouts de voyage, d’errance, d’ailleurs, ça me tourneboule un peu le cœur. Dans mon sac, j’ai mis des souvenirs du Kirghizstan, des foulards, du feutre, de la musique et des regards d’enfants. Le garçon d’à côté avait choisi depuis des semaines de venir, et c’était chouette de se dire ça, qu’on partait travadrouiller ensemble. Il fallait une heure de bus et une balade matinale sur une petite route, les champs sur le côté et le soleil qui brille dans l’herbe avant d’arriver à la station-service. J’avais revendu nos billets de train quelques jours plus tôt, j’avais bien trop envie de lever le pouce à nouveau. Finalement, est-ce que ça marche encore de dire que chaque trajet est un trajet dingue ? Peu importe, chaque trajet est un trajet dingue. Il y a ces deux hommes qui ont bien trop bu qui proposent de laisser les clés de la voiture au garçon d’à côté s’il peut conduire jusqu’à Saint-Denis. Et l’épopée qui suit. Il y a leur façon d’inventer la langue, nos mondes qui s’entrechoquent et cette poésie de la friction. Je suis renommée Amélie Poulain prof de grammaire pour clandestins, et quand je parle du voyage de l’été dernier, Istanbul jusque là, Paname, ils disent, chapeau melon et slip en cuir ! et puis, c’est même plus chapeau bas… c’est révérence casquette ! On est de bons gens, de vrais bonhommes, et je ris, tellement. Alors voilà, une seule voiture, une bonne action, et une chouette discussion. A Saint-Denis après avoir quitté nos deux compagnons de fortune, nous pique-niquons au bord du canal, nous étirons ce moment pendant pendant pendant, avant de nous séparer – à demain, à demain tu sais.
Un peu plus tard, quand je sors de la gare, je me souviens de ce rond-point où j’avais lu il y a presque deux ans un livre de Cendrars, et évidemment, il n’y a pas de hasard. C’est une jolie rencontre (merci Twitter) qui me récupère en voiture, et alors, je suis là pour ça, pour parler voyage au milieu du rayon littérature. (La vie dingue.) Dans la grande médiathèque, il y a comme une yourte, des tapis, des coussins, des tentures, de la musique kirghize, et de grands adolescents qui lisent des textes qu’ils ont écrits sur des voyages inventés dans des pays en –stan, je raconte l’année d’avant, l’autre vie, à quoi ça ressemble là-bas, en quoi ça s’éloigne d’ici. C’est émouvant de les entendre, de les voir trébucher sur les mots inconnus, ceux aux consonances étrangères, j’ai des images dans ma tête éparpillées, j’essaie de les partager.
Du matin à l’après-midi, je lis sur l’immense terrasse en plein soleil deux BD qui m’émeuvent à un point – Sarajevo, encore, toujours, et puis autre chose. Et puis je redescends les escaliers, à nouveau les coussins de la yourte, une toute petite rencontre mais grande dans mon ventre, j’aime raconter les souvenirs de voyage et la façon de mettre un pied devant l’autre sur la route.
Et puis c’est fini. Et puis on repart, la gare, Paris, le petit appartement de D. et M. et la table qu’on déplie pour y passer tous les quatre, la longue nuit dans le radeau improvisé et les pancakes au petit-déjeuner à la pâte de spéculoos. Plus tard, nous pique-niquons au jardin du Luxembourg, avec les copains respectifs qu’on n’a pas trop l’occasion de mêler, mais quand même, c’est bien, de prendre des nouvelles, même s’il y a trop de monde sur ces pelouses. Plus tard, ce sont D. et B. qui nous raccompagnent, on parle de rencontres et de voyages, immobiles et aussi lointains, et on monte dans le train.
Il parle d’atterrissages en douceur, et je voudrais savoir faire ça. Mais plutôt, je me jette dans la gueule du loup à chaque fois, dans les choses pénibles et pesantes, et les sanglots à côté de la baraque à frites. Alors le lendemain, se promettre de ne rien forcer. Je vais à la rencontre de ceux avec qui j’ai travaillé dans une autre vie, je vais saluer et écouter des auteurs, et puis je vais acheter des sandales à la couleur parfaite et encore boire du thé glacé en terrasse avec A. parce qu’il est rentré. Il me tend l’enveloppe que Mam a fait passer pour moi, des boucles turquoises à accrocher à mes oreilles, il fait des bulles de savon qui éclatent dans le soleil. Quand je reviens à l’appartement, il est déjà tard, je parle avec E. pas vue depuis cinq jours au moins, et quand le garçon d’à côté arrive, le soleil est encore bien là, alors il propose de descendre pique-niquer. Ni une ni deux, nous préparons une salade, nous attrapons fromages, galettes de riz, eau-qui-pique, chocolat et olives marinées et nous descendons la rue jusqu’au parc, je déplie mon drap d’Istanbul, je lui dis, c’est sur celui-ci que j’ai dormi à la belle étoile en Serbie, parce qu’il y a ce souvenir qui tellement nous lie. Pieds nus dans l’herbe, jusqu’à la pluie.
La pluie à nouveau le lendemain, alors qu’on prend un verre avec Hanneton en terrasse après le concert fou de Bertrand Belin dans un appartement. La voix de sa batteuse, l’énergie du lieu, ce que ça me transporte, où ça m’emmène, loin, loin, l’ambiance là sur le parquet, et plus tard, donc, la pluie qui s’abat en trombes, alors que nous nous racontons les relations avec les gens qui comptent, et combien ça peut être difficile parfois. Je rentre sous l’eau, et à mi-chemin, j’appelle le garçon d’à côté pour lui dire que c’est compliqué de venir, que j’ai peur que mes affaires n’aient pas le temps de sécher avant le lendemain. Il rappelle deux minutes plus tard en disant tu sais j’avais oublié, mais il y a un séchoir. Alors je reprends la route, ça descend et ça pédale, c’est magnifique, toute cette eau sous les roues, toutes les flaques, tout ce ciel, et puis j’arrive, il me tend une grande serviette et une tasse de tisane.
Le lendemain, je fouille chez les bouquinistes pour trouver une carte de l’Angleterre pour pouvoir y faire du stop d’ici quelques jours, et en fin d’après-midi, nous partons à pied avec le garçon d’à côté, les billets pour le concert de Vincent Delerm en poche. Nous allons manger des sushis en parlant beaucoup, et plus tard, nous nous installons dans la grande salle. J’ai un peu peur, un peu peur que celui dont j’aime tant le travail ne parle pas à cet autre dont j’aime tant tout, mais bientôt je l’entends rire, je le sens être touché, alors c’est gagné. C’est bon de le revoir, ça fait longtemps, j’aime les paroles qui me viennent aux lèvres quand je ne pense pas les connaître encore, l’autodérision, l’atmosphère et comme il dit bien le fait de tomber amoureux, cet état-là. Quand nous sortons, les trottoirs sont mouillés, ça devient presque une habitude, ces belles journées et ces draches du soir, et je voudrais que ça continue comme ça encore, les orages qui éclatent, à peine après que j’ai passé la porte et que je sens l’odeur du risotto aux champignons, ou bien alors que je suis encore sur la route, sentir l’eau tout contre la peau, le ciel se décharger et les étoiles filer.
La vie ce printemps-là, c’est mon ancien appartement un dimanche matin, pendant que C. fait une soupe à la courgette, le salon est tellement lumineux, et les mots aussi, tellement lumineux ; c’est le gilet orange fluo trouvé au marché aux puces pour le mettre à vélo ; c’est les stands avec des gens dedans qui changent le monde doucement ; c’est cette chanson en boucle, courage / avançons / un jour arrivera / où nous arriverons ; ce sont les rendez-vous pour clore de beaux projets qui se superposent avec d’autres pour en construire de nouveaux, une, deux, trois bibliothèques, on me propose d’animer des espaces d’écriture sur un thème parfait, et la veille j’avais récupéré les évaluations des participantes à des ateliers d’il y a déjà longtemps. Ce qui m’a plu c’était de écrir des choses librement, c’est le fait de dédié les poêmes à des personnes qui nous sont chèrs, c’est l’échange qu’il y a eu en groupe et aussi le fait d’être mélangé, ça m’a permet d’exprimer mes sentiments, c’est une bel après-midi dans les cœurs.
La vie ce printemps-là, ce sont surtout, disons-le, oui, de belles après-midis dans les cœurs.